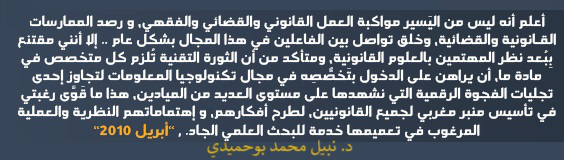Résumé
L’histoire politique, institutionnelle, culturelle et socioéconomique du Canada qui a été très mouvementée a été aussi marquée par un ensemble de faits et d’événements comme la «constitutionnalisation», la codification, la modification et la fédéralisation, qui, réunis, ont incontestablement changé non seulement le cours de l’histoire canadienne, mais aussi l’ensemble de la réalité sociétale du Canada d’aujourd’hui.
Mots clés : Constitution, codification, modification, fédéralisation, partages des compétences, droits et libertés.
Abstract
The political, institutional, cultural and socio-economic history of Canada, which has been very eventful, has also been market by a set of facts and events such as “Constitutionalization”, codification, modification and federalization, which, taken together, have undoubtedly changed not only the course of Canadian history, but also the entire societal reality of Canada today.
Key words: Constitution, codification, modification, federalization, sharing of powers, rights and freedoms.
Trois groupes de faits marquants dans l’histoire constitutionnelle du Canada sont aussi hautement caractéristiques de l’histoire du Canada : la codification, la modification et la fédéralisation. Ce sont ces faits réunis qui ont contribué solidairement à la construction du Canada d’aujourd’hui et à son système fédéral. Ce sont les faits qui produisent le droit : ex-facto oritur jus.
Premier groupe de faits marquants : codification constitutionnelle, corollaire et situations non codifiées
La codification, juridiquement envisagée, est la réunion ou l’assemblage des textes juridiques légaux dans un corpus, dans un code, dans un recueil qui est l’ensemble des lois, décrets, jurisprudences, doctrines et faits relatifs à une même discipline, à une matière bien précise, une matière spéciale, comme le droit constitutionnel ou le corpus constitutionnel en l’occurrence, ou encore comme le Code civil Français du 21 mars 1804, ou le Code civil du Québec du 1er janvier 1994.
La Constitution du Canada, qui est une succession évolutive lointaine d’actes, d’usages, de coutumes et de conventions tantôt houleux, tantôt calmes,[1]enracinée à la fois dans l’histoire française, britannique et canadienne, remonte, en effet, jusqu’au début du XIIIème siècle[2]. « Immédiatement après la découverte du Canada, écrivait déjà J.-C. Taché, en 1854, dans « De la Tenure Seigneuriale en Canada… » : Le premier soin des rois de France fut de travailler à coloniser le pays dans le but d’évangéliser et civiliser les Sauvages, et de procurer l’avantage des sujets du roi[3] ».
C’est une composition, cette Constitution canadienne, solide et cohérente, de normes écrites (lois, décrets, arrêtés), de jurisprudence, et de pratiques politiques (coutumes, usages, conventions), ayant valeur constitutionnelle. Ces normes, jurisprudence, pratiques et expériences ont fait de la Constitution canadienne sa force et son originalité, à l’instar de la Constitution britannique dont elle tire indéniablement une grande partie de sa longue histoire[4].
Ainsi, cet ensemble, ce corpus constitutionnel complexe, ramifié et extraordinaire, « est la loi suprême du Canada », dispose l’article 52 de la loi constitutionnelle de 1982 modifiée et complétée à plusieurs reprises. « Elle rend inopérante », poursuit le même article, toute disposition incompatible avec celles de ladite Constitution. Celle-ci a la particularité d’avoir pour objet la Charte des droits et libertés, ainsi que les droits ancestraux ou résultant de traités des peuples autochtones : Indiens, Inuits et Métis, « issus d’accords sur les revendications territoriales », sur d’autres droits acquis et qui sont « garantis également aux personnes des deux sexes » (Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 et 35.1).
Les droits et libertés prévus dans la Charte sont garantis par la Constitution, par la justice et dans leur application et se rapportent à des domaines aussi variés que riches démocratiquement : libertés fondamentales, libertés démocratiques, libertés de circulation et d’établissements, garanties juridiques, droits à l’égalité, langues officielles du Canada, droits à l’instruction dans la langue de la minorité, maintien et application de ces droits et libertés, péréquation et résorption des inégalités régionales (Loi constitutionnelle de 1982).
Les Lois constitutionnelles du Canada « récent », ce faisceau constitutionnel ou bloc de constitutionnalité canadien, au nombre de trente textes, étalés sur une longue période (1867-1982), dont six abrogés et vingt-quatre changé d’intitulés, est désormais en vigueur, dans tout le Canada, en deux versions officielles : anglaise et française, et ce depuis 1990. Néanmoins, la version française dont la rédaction fut prévue par l’art.55 de la Loi constitutionnelle de 1982, déposée en rapport définitif au Parlement, en décembre 1990, par le comité de rédaction constitutionnelle française, créée en 1984, reste tout de même, hormis quelques points d’interprétation sujets à discussion, voire critiquables, une version globalement de haute qualité et d’une cohérence pertinente[5].
S’agissant du fait, pour ladite version, d’avoir ou de ne pas avoir force de loi, un désaccord intestin en la matière, étayé par la primauté des lois impériales britanniques, lesquelles interdisaient toute modification des textes constitutionnels venant des parlements coloniaux, avait finalement été clarifié et dissipé. Néanmoins, il aura fallu attendre la Loi de 1982 sur le Canada, loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, organisant le « rapatriement » de la Constitution canadienne depuis le Royaume-Uni, marquant ainsi la dernière approbation donnée par le Parlement de Westminster sur la gestion et l’administration des affaires intérieures du Canada[6].
L’annexe A, version française, au texte de la loi en langue anglaise, précise, dans son paragraphe 1, que «la partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A, a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise correspondante » ; et le paragraphe 2, du même texte, d’ajouter : « La Loi constitutionnelle de 1982, énoncée à l’annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses dispositions[7]».
Les codifications réitérées des nombreux textes constitutionnels, sont au nombre de 42 au total, si l’on partait depuis la Magna Carta de 1215, jusqu’aux implications de la séparation des pouvoirs et du système fédéral, on relèvera : la Nouvelle-France 1534, l’Acte of Settlement 1701, la Proclamation royale de 1763, l’Acte de Québec de 1774, l’Acte constitutionnel de 1791, séparant le Haut-Canada (Ontario) du Bas-Canada (Québec), Act d’Union des deux provinces, Ontario et Québec de 1840, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, le rapatriement de la Constitution de 1982, la Common Law des tribunaux britanniques et canadiens, les pratiques et usages politiques ou conventions constitutionnelles, les droits autochtones, les textes résultant du pouvoir monarchique, …
Toutes ces codifications, situations et pratiques non codifiées ont été à l’origine de l’adoption et de l’esprit de la Loi constitutionnelle de 1867, antérieurement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 lequel est devenu depuis 1949 la loi sur Terre-Neuve-et-Labrador, et puis la codification par la suite de la loi constitutionnelle de 1982, qui contient la Charte Canadienne des droits et libertés, mentionnée plus-haut, ainsi que les annexes des deux Lois constitutionnelles de 1867 et de 1982, lois qui furent par la suite modifiées, corrigées et complétées à maintes reprises[8].
Deuxième groupe de faits marquants : modification constitutionnelle, interprétation et sens de la Constitution
La modification, au sens juridique, est la correction, l’abrogation, la révision, le changement, le remaniement ou l’amendement apporté à une loi, un décret, une ordonnance, un contrat, un règlement intérieur ou aux textes constitutionnels en l’occurrence. Elle prend aussi un sens d’interprétation évolutive, et de révision desdits textes constitutionnels, qui accompagne l’évolution de la société canadienne, et sa transformation, tout en réactivant, en régénérant leur contenu, leur corps, à l’instar d’un arbre, être vivant[9] susceptible de croître, de se développer et de s’épanouir « à l’intérieur de ses limites naturelles[10]», mais qui a aussi besoin d’air, d’espace, d’eau, de soins et d’entretien. Formulé autrement : l’interprétation de la Constitution et sa modification vont de pair avec l’évolution de la société : elles sont indubitablement intimement corrélées.
En revanche, certains éléments de ce corps, de cet organisme, se développent, changent, plus ou moins, d’aspect, mais ne disparaissent pas totalement, et c’est justement le cas de la Constitution canadienne qui a su préserver certaines de ses institutions qui dataient de 1663 lorsque Louis XIV organisa la colonie de Nouvelle-France, en instituant la fonction du gouverneur, du lieutenant-général et de l’intendant, autorités qui représentaient alors la Couronne au Canada. Ces institutions et autorités, outre la Province de Québec tout entière, sont toujours présentes au sein du système fédéral canadien aujourd’hui, à l’exemple de : sujets de Sa Majesté, la Couronne, le gouverneur général, le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, en faveur de la Couronne représentée par le gouverneur général, colonie, district, cantons, assemblées provinciales…L.C. de 1867 et de 1982[11]. Même la question des tenures, survivance de la féodalité foncière, ne sera terminée qu’en 1980, J.-P. Wallot avait déjà en 1969 écrit à ce propos : « Mais la pauvreté des censitaires fit que, même en 1968, la question des tenures n’est pas encore entièrement éteinte [12]».
Depuis pratiquement la loi constitutionnelle de 1867 jusqu’à celle de 1982, les différentes procédures de modification afférentes à la majeure partie du bloc constitutionnel du Canada relevaient de la compétence du Parlement britannique[13]. Toutefois, parallèlement, le pays jouissait, sous l’égide du Royaume-Uni toujours, d’une autonomie interne relative, d’un gouvernement responsable (1848)[14], et d’une autonomie externe acquise de facto durant l’entre-deux-guerres et après[15]. Aussi, le Parlement du Canada se voyait-il habilité à légiférer dans un certain nombre de domaines, comme la création de nouvelles provinces, la souveraineté interne ou l’autonomie du Canada et des dominions (Statut de Westminster du 11 déc. 1931), l’assurance-emploi, ou la modification de sa constitution interne[16]…Néanmoins, toutes les modifications de la Constitution touchant de près ou de loin aux prérogatives de la Couronne au Canada ne sont faites que par proclamation du gouverneur général - autorité représentative du Roi- « sous le grand sceau du Canada », c’est le cas de la charge de Roi, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur, du nombre de députés dans une province, l’usage du français ou de l’anglais, la composition de la Cour suprême, ou la forme ou le contenu de l’un de ces points susmentionnés (art.41 de la Constitution 1982).
Les compétences et la souveraineté du Parlement fédéral (Sénat et Chambre des Communes) et celles des parlements des provinces et territoires (Assemblées législatives), se sont largement développées depuis l'adoption de trois couples de procédures graduelles de modification enchâssées dans les articles 38 à 47 de la loi constitutionnelle de 1982 : mode d’action normal ou général de remaniement, ou consentement unanime pour pouvoir amender, modification bilatérale ou multilatérale, amendement unilatéral fédéral ou unilatéral provincial[17]. Une dizaine de modifications et de corrections constitutionnelles furent apportées dont les plus importantes furent l’officialisation de l'égalité du français et de l'anglais au Nouveau-Brunswick le renforcement de la protection des droits autochtones, les modifications constitutionnelles relatives aux écoles religieuses apportées par le Québec et Terre-Neuve[18].
La Constitution canadienne, au sens du bloc de constitutionnalité, est en réalité composée de plusieurs parties dont la modification ou le remaniement, très rigide, rigide, souple ou très souple, varie considérablement selon que la partie concernée de la constitution renferme des textes constitutionnels fondamentaux comme ceux relatifs aux prérogatives politiques et militaires de la monarchie constitutionnelle, au fédéralisme, à la Charte des droits et libertés ou à la séparation des pouvoirs, ou alors de simples règles constitutionnelles édictées par des lois ordinaires, des décrets ou de simples règles coutumières nécessitant peu, très peu voire pas de formalités procédurales et institutionnelles exigeantes[19].
Troisième groupe de faits marquants : fédéralisation constitutionnelle, partage des compétences, protection des droits et séparation des pouvoirs
La fédéralisation peut se définir comme un processus institutionnel, politico-administratif et socio-économique, consistant à transformer progressivement un ensemble d’entités territoriales politiques indépendantes en État fédéral, à l’exemple du dominion du Canada du 1er juillet 1867, et sa fédéralisation par la suite, ou éventuellement, un État unitaire concentré (Maroc)[20], centralisé (France)[21], décentralisé (Royaume-Uni)[22], ou régionalisé (Italie)[23]. Seulement si, lesdits États, consentent un jour, ce qui est peu probable, à devenir des États fédéraux, à l’instar de la Belgique, État régional, devenue, officiellement, depuis 1994, un État fédéral (art. 1er de la Constitution du 17 février 1994[24]). La fédéralisation s’entendrait aussi comme le degré de partage des compétences, asymétriques, mais solidaires, entre l’État fédéral déjà existant et les États fédérés qui le composent, à l’exemple aujourd’hui du Canada et ses provinces ou de la Suisse et ses cantons, de l’Allemagne et ses länder, de l’Australie ou des États-Unis d’Amérique et leurs États fédérés[25].
La création de l’Union fédérale du Canada, qui fut basée sur un compromis entre les deux principaux courants de pensée politique d’alors,[26]a été établie, sous l’égide de la couronne du Royaume-Uni, depuis la Loi constitutionnelle du 29 mars 1867, avec au départ les quatre provinces existantes à l’époque : l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et la nécessité d’admettre, par la suite, d’autres entités de l’Amérique du Nord britannique dans l’union (Préambule et art. 3-7 de la L.C. 1867)[[27]]url:jj . En effet, d’autres provinces furent rattachées à la fédération du Canada : le Manitoba (1870), la Colombie-Britannique (1871), l’Île-du-Prince-Édouard (1873), l’Alberta et la Saskatchewan (1905), et Terre-Neuve-et-Labrador enfin (1949) [[28]]url:jj . Les arrêtés royaux complétèrent le « touts-inclus » en transférant au Canada tous les territoires et possessions britanniques ainsi que les îles y adjacentes : terre de Rupert et territoire du Nord-Ouest (23 juin 1870), territoires de Yukon et de Nunavut (31 juillet 1880) [[29]]url:jj .
Le fédéralisme canadien est un modèle de politiques publiques, de gestion et d’administration de l’État du Canada de manière globale. Aussi, englobe-t-il, en effet, l’étendue des territoires sur lesquels règne sa souveraineté, les populations qui y vivent et les instances qui les gouvernent.
Le fédéralisme du Canada qui est composé d’un pouvoir fédéral et des pouvoirs fédérés, de dix provinces et trois territoires, s’étend sur une superficie avoisinant les dix millions de km2. Sans remonter jusqu’au Traité de Paris en 1763, début de délimitation des frontières nationales et internationales, [[30]]url:jj la seule frontière, en dehors des océans : Atlantique à l’est, Pacifique à l’ouest, Arctique au nord, demeurent les E.U.A au sud et l’Alaska au nord-ouest, qui est lui-même un État des E.U [[31]]url:jj . Sa géographie est vaste et diversifiée : hydrographie (océans, fleuves et lacs), montagnes, prairies, îles, forêts, ressources énergétiques et minérales ; et son économie aussi (services, agriculture, agroalimentaire, transports, industrie aéronautique, commerce extérieur, échange, exportation, investissement… [[32]]url:jj ).
Stimulée par une immigration permanente très élevée, la population canadienne dépasse aujourd’hui les 41 millions d’habitants, répartis inégalement entre provinces et territoires, très variée et caractérisée par une ethnicité très riche. Une population multiple origine qui a contribué à la richesse et au paysage ethnoculturel du Canada. On relèvera ainsi, selon les données statistiques, quelque 70% d’origine européenne [[33]]url:jj , plus de 16% d’origine Sud-Asiatique, Chinois et Noirs, plus de 6% d’origine autochtone (Indiens d’Amérique du Nord, Métis et Inuits [[34]]url:jj ), et 5% de musulmans, dont 1% arabe. Le reste de la population totale, c’est-à-dire un peu moins de 3%, est composé essentiellement d’une multitude d’ethnies, 242 au total, qui demeure tout de même, vu le nombre, une catégorie socioculturelle insignifiante démographiquement parlant [[35]]url:jj .
Aussi l’ensemble et la structure des finances publiques du Canada, fédérales et provinciales, (ressources, dépenses, gestion, cadre budgétaire et comptable et une péréquation fiscale verticale et horizontale), puisent leurs forces et consistance dans toutes ces richesses, gisements et potentialités océanographies, géographiques, géologiques et démographiques [[36]]url:jj .
Les différents échelons du fédéralisme canadien caractérisés par une souplesse, une collaboration et une perméabilité singulières, se présentent comme suit : le pouvoir exécutif est composé de la couronne britannique, le Roi pouvoir exécutif, depuis le décès de la Reine Élisabeth le 8 septembre 2022, représenté au niveau central ou fédéral par le gouverneur-général et le Conseil Privé du Roi, pour le Canada, et le gouvernement du Canada, et au niveau fédéré par les lieutenant-gouverneurs au nom du Roi, et les gouvernements fédérés (pouvoir exécutif des provinces et territoires).
Le pouvoir législatif est composé du Roi, pouvoir législatif, d’une chambre haute appelée le Sénat, 105 sénateurs, avec la possibilité pour la couronne britannique d’augmenter, dans certains cas, le nombre de sénateurs de 4 à 8, sans toutefois que le nombre total n’excède 113 sénateurs nommés à vie, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la retraite à 75 ans. Le gouverneur-général représentant de la couronne au Canada, députera (ou mandatera) des représentants au Sénat au nom du Roi. La Chambre des Communes est composée de 308 députés, sur un mandat de 5 ans, et le gouverneur-général, en sa qualité d’autorité législative, siège au nom de la couronne. Les représentants et sénateurs des dix provinces et trois territoires sont numériquement inégalement répartis au sein du Parlement fédéral (Loi constitutionnelle de 1867, révisée).
Au niveau fédéré, on relèvera le pouvoir législatif - ou la législature des provinces et des territoires - qui se compose du lieutenant-gouverneur et une seule chambre appelée Assemblée législative des provinces et des territoires, pour un mandat de quatre ans, ou de cinq ans pour les Assemblées de la Nouvelle-Écosse et du Yukon. Seule la législature du Québec est composée - outre le lieutenant-gouverneur représentant de la couronne- de deux chambres : le Conseil législatif du Québec et l’Assemblée législative du Québec. Les membres du Conseil législatif sont des sénateurs nommés à vie par le lieutenant-gouverneur (Loi constitutionnelle de 1867 révisée), au nom du Roi, depuis la mort de la Reine.
Le pouvoir judiciaire qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, départage légitimement ses attributions, ses compétences et les matières objets du contentieux, selon les différents niveaux institutionnels qui le composent et qui sont respectivement dépositaires d’une parcelle de l’autorité judiciaire conformément à l’étendue de son territoire. Ainsi, à l’échelle de l’Empire britannique au Canada, se situe la couronne, autorité judiciaire, en la personne du gouverneur général. À l’échelle fédérale proprement dite, se situent la Cour suprême, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la Cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt et les Commissions et Tribunaux administratifs fédéraux.
À l’échelle provinciale et territoriale se placent les Cours d’appel provinciaux et territoriaux, les Cours supérieures provinciales et territoriales, et les Cours provinciales et territoriales. À l’échelle des subdivisions administratives territoriales et électorales les districts qui comprennent les comtés, les divisions de comtés, les villes, les townships, les cités et les villages, se situent les Tribunaux de l’aménagement du territoire, les Tribunaux de famille, les Tribunaux pour adolescents, la Cour des petites créances et la Cour de succession [[37]]url:jj .
Le pouvoir judiciaire provincial (judicature), système juridique dualiste fonctionnant par la commun Law, système anglophone, et le droit civil, système francophone, relève de la compétence du gouverneur-général : cours supérieures, district et comté, pour tout ce qui concerne la nomination des juges, leur révocation, leur salaire, ou la création, le maintien et l’organisation d’une Cour générale d’appel pour le Canada. Les juges des Cours supérieures sont choisis parmi les membres des barreaux de chaque province, et restent en fonction jusqu’à l’âge de 75 ans révolus, à moins d’une révocation ou de décès, leurs salaires sont payés par le Parlement du Canada (Loi constitutionnelle de 1867, art. 96-101).
Aujourd’hui, le fédéralisme canadien, qui se veut asymétrique et solidaire, se situe dans des perspectives d’avenir toutes nouvelles, innovantes, et ambitionne d’instituer et de véhiculer, dans une approche comparative, un modèle servant d’exemple, un paradigme pour le Canada et pour d’autres fédérations ou États en devenir de l’être. Il se conçoit comme un régime de coopération entre les différents paliers du pouvoir, un système de péréquation horizontale et verticale, soucieux de son histoire, de son économie, de l’environnement, des droits et des libertés de toutes les strates de la société qui le composent [[38]]url:jj , de toutes les composantes institutionnelles de son histoire, de sa culture, de son unité, de son identité [[39]]url:jj .
Premier groupe de faits marquants : codification constitutionnelle, corollaire et situations non codifiées
La codification, juridiquement envisagée, est la réunion ou l’assemblage des textes juridiques légaux dans un corpus, dans un code, dans un recueil qui est l’ensemble des lois, décrets, jurisprudences, doctrines et faits relatifs à une même discipline, à une matière bien précise, une matière spéciale, comme le droit constitutionnel ou le corpus constitutionnel en l’occurrence, ou encore comme le Code civil Français du 21 mars 1804, ou le Code civil du Québec du 1er janvier 1994.
La Constitution du Canada, qui est une succession évolutive lointaine d’actes, d’usages, de coutumes et de conventions tantôt houleux, tantôt calmes,[1]enracinée à la fois dans l’histoire française, britannique et canadienne, remonte, en effet, jusqu’au début du XIIIème siècle[2]. « Immédiatement après la découverte du Canada, écrivait déjà J.-C. Taché, en 1854, dans « De la Tenure Seigneuriale en Canada… » : Le premier soin des rois de France fut de travailler à coloniser le pays dans le but d’évangéliser et civiliser les Sauvages, et de procurer l’avantage des sujets du roi[3] ».
C’est une composition, cette Constitution canadienne, solide et cohérente, de normes écrites (lois, décrets, arrêtés), de jurisprudence, et de pratiques politiques (coutumes, usages, conventions), ayant valeur constitutionnelle. Ces normes, jurisprudence, pratiques et expériences ont fait de la Constitution canadienne sa force et son originalité, à l’instar de la Constitution britannique dont elle tire indéniablement une grande partie de sa longue histoire[4].
Ainsi, cet ensemble, ce corpus constitutionnel complexe, ramifié et extraordinaire, « est la loi suprême du Canada », dispose l’article 52 de la loi constitutionnelle de 1982 modifiée et complétée à plusieurs reprises. « Elle rend inopérante », poursuit le même article, toute disposition incompatible avec celles de ladite Constitution. Celle-ci a la particularité d’avoir pour objet la Charte des droits et libertés, ainsi que les droits ancestraux ou résultant de traités des peuples autochtones : Indiens, Inuits et Métis, « issus d’accords sur les revendications territoriales », sur d’autres droits acquis et qui sont « garantis également aux personnes des deux sexes » (Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 et 35.1).
Les droits et libertés prévus dans la Charte sont garantis par la Constitution, par la justice et dans leur application et se rapportent à des domaines aussi variés que riches démocratiquement : libertés fondamentales, libertés démocratiques, libertés de circulation et d’établissements, garanties juridiques, droits à l’égalité, langues officielles du Canada, droits à l’instruction dans la langue de la minorité, maintien et application de ces droits et libertés, péréquation et résorption des inégalités régionales (Loi constitutionnelle de 1982).
Les Lois constitutionnelles du Canada « récent », ce faisceau constitutionnel ou bloc de constitutionnalité canadien, au nombre de trente textes, étalés sur une longue période (1867-1982), dont six abrogés et vingt-quatre changé d’intitulés, est désormais en vigueur, dans tout le Canada, en deux versions officielles : anglaise et française, et ce depuis 1990. Néanmoins, la version française dont la rédaction fut prévue par l’art.55 de la Loi constitutionnelle de 1982, déposée en rapport définitif au Parlement, en décembre 1990, par le comité de rédaction constitutionnelle française, créée en 1984, reste tout de même, hormis quelques points d’interprétation sujets à discussion, voire critiquables, une version globalement de haute qualité et d’une cohérence pertinente[5].
S’agissant du fait, pour ladite version, d’avoir ou de ne pas avoir force de loi, un désaccord intestin en la matière, étayé par la primauté des lois impériales britanniques, lesquelles interdisaient toute modification des textes constitutionnels venant des parlements coloniaux, avait finalement été clarifié et dissipé. Néanmoins, il aura fallu attendre la Loi de 1982 sur le Canada, loi donnant suite à une demande du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, organisant le « rapatriement » de la Constitution canadienne depuis le Royaume-Uni, marquant ainsi la dernière approbation donnée par le Parlement de Westminster sur la gestion et l’administration des affaires intérieures du Canada[6].
L’annexe A, version française, au texte de la loi en langue anglaise, précise, dans son paragraphe 1, que «la partie de la version française de la présente loi qui figure à l’annexe A, a force de loi au Canada au même titre que la version anglaise correspondante » ; et le paragraphe 2, du même texte, d’ajouter : « La Loi constitutionnelle de 1982, énoncée à l’annexe B, est édictée pour le Canada et y a force de loi. Elle entre en vigueur conformément à ses dispositions[7]».
Les codifications réitérées des nombreux textes constitutionnels, sont au nombre de 42 au total, si l’on partait depuis la Magna Carta de 1215, jusqu’aux implications de la séparation des pouvoirs et du système fédéral, on relèvera : la Nouvelle-France 1534, l’Acte of Settlement 1701, la Proclamation royale de 1763, l’Acte de Québec de 1774, l’Acte constitutionnel de 1791, séparant le Haut-Canada (Ontario) du Bas-Canada (Québec), Act d’Union des deux provinces, Ontario et Québec de 1840, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867, le rapatriement de la Constitution de 1982, la Common Law des tribunaux britanniques et canadiens, les pratiques et usages politiques ou conventions constitutionnelles, les droits autochtones, les textes résultant du pouvoir monarchique, …
Toutes ces codifications, situations et pratiques non codifiées ont été à l’origine de l’adoption et de l’esprit de la Loi constitutionnelle de 1867, antérieurement l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 lequel est devenu depuis 1949 la loi sur Terre-Neuve-et-Labrador, et puis la codification par la suite de la loi constitutionnelle de 1982, qui contient la Charte Canadienne des droits et libertés, mentionnée plus-haut, ainsi que les annexes des deux Lois constitutionnelles de 1867 et de 1982, lois qui furent par la suite modifiées, corrigées et complétées à maintes reprises[8].
Deuxième groupe de faits marquants : modification constitutionnelle, interprétation et sens de la Constitution
La modification, au sens juridique, est la correction, l’abrogation, la révision, le changement, le remaniement ou l’amendement apporté à une loi, un décret, une ordonnance, un contrat, un règlement intérieur ou aux textes constitutionnels en l’occurrence. Elle prend aussi un sens d’interprétation évolutive, et de révision desdits textes constitutionnels, qui accompagne l’évolution de la société canadienne, et sa transformation, tout en réactivant, en régénérant leur contenu, leur corps, à l’instar d’un arbre, être vivant[9] susceptible de croître, de se développer et de s’épanouir « à l’intérieur de ses limites naturelles[10]», mais qui a aussi besoin d’air, d’espace, d’eau, de soins et d’entretien. Formulé autrement : l’interprétation de la Constitution et sa modification vont de pair avec l’évolution de la société : elles sont indubitablement intimement corrélées.
En revanche, certains éléments de ce corps, de cet organisme, se développent, changent, plus ou moins, d’aspect, mais ne disparaissent pas totalement, et c’est justement le cas de la Constitution canadienne qui a su préserver certaines de ses institutions qui dataient de 1663 lorsque Louis XIV organisa la colonie de Nouvelle-France, en instituant la fonction du gouverneur, du lieutenant-général et de l’intendant, autorités qui représentaient alors la Couronne au Canada. Ces institutions et autorités, outre la Province de Québec tout entière, sont toujours présentes au sein du système fédéral canadien aujourd’hui, à l’exemple de : sujets de Sa Majesté, la Couronne, le gouverneur général, le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, en faveur de la Couronne représentée par le gouverneur général, colonie, district, cantons, assemblées provinciales…L.C. de 1867 et de 1982[11]. Même la question des tenures, survivance de la féodalité foncière, ne sera terminée qu’en 1980, J.-P. Wallot avait déjà en 1969 écrit à ce propos : « Mais la pauvreté des censitaires fit que, même en 1968, la question des tenures n’est pas encore entièrement éteinte [12]».
Depuis pratiquement la loi constitutionnelle de 1867 jusqu’à celle de 1982, les différentes procédures de modification afférentes à la majeure partie du bloc constitutionnel du Canada relevaient de la compétence du Parlement britannique[13]. Toutefois, parallèlement, le pays jouissait, sous l’égide du Royaume-Uni toujours, d’une autonomie interne relative, d’un gouvernement responsable (1848)[14], et d’une autonomie externe acquise de facto durant l’entre-deux-guerres et après[15]. Aussi, le Parlement du Canada se voyait-il habilité à légiférer dans un certain nombre de domaines, comme la création de nouvelles provinces, la souveraineté interne ou l’autonomie du Canada et des dominions (Statut de Westminster du 11 déc. 1931), l’assurance-emploi, ou la modification de sa constitution interne[16]…Néanmoins, toutes les modifications de la Constitution touchant de près ou de loin aux prérogatives de la Couronne au Canada ne sont faites que par proclamation du gouverneur général - autorité représentative du Roi- « sous le grand sceau du Canada », c’est le cas de la charge de Roi, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur, du nombre de députés dans une province, l’usage du français ou de l’anglais, la composition de la Cour suprême, ou la forme ou le contenu de l’un de ces points susmentionnés (art.41 de la Constitution 1982).
Les compétences et la souveraineté du Parlement fédéral (Sénat et Chambre des Communes) et celles des parlements des provinces et territoires (Assemblées législatives), se sont largement développées depuis l'adoption de trois couples de procédures graduelles de modification enchâssées dans les articles 38 à 47 de la loi constitutionnelle de 1982 : mode d’action normal ou général de remaniement, ou consentement unanime pour pouvoir amender, modification bilatérale ou multilatérale, amendement unilatéral fédéral ou unilatéral provincial[17]. Une dizaine de modifications et de corrections constitutionnelles furent apportées dont les plus importantes furent l’officialisation de l'égalité du français et de l'anglais au Nouveau-Brunswick le renforcement de la protection des droits autochtones, les modifications constitutionnelles relatives aux écoles religieuses apportées par le Québec et Terre-Neuve[18].
La Constitution canadienne, au sens du bloc de constitutionnalité, est en réalité composée de plusieurs parties dont la modification ou le remaniement, très rigide, rigide, souple ou très souple, varie considérablement selon que la partie concernée de la constitution renferme des textes constitutionnels fondamentaux comme ceux relatifs aux prérogatives politiques et militaires de la monarchie constitutionnelle, au fédéralisme, à la Charte des droits et libertés ou à la séparation des pouvoirs, ou alors de simples règles constitutionnelles édictées par des lois ordinaires, des décrets ou de simples règles coutumières nécessitant peu, très peu voire pas de formalités procédurales et institutionnelles exigeantes[19].
Troisième groupe de faits marquants : fédéralisation constitutionnelle, partage des compétences, protection des droits et séparation des pouvoirs
La fédéralisation peut se définir comme un processus institutionnel, politico-administratif et socio-économique, consistant à transformer progressivement un ensemble d’entités territoriales politiques indépendantes en État fédéral, à l’exemple du dominion du Canada du 1er juillet 1867, et sa fédéralisation par la suite, ou éventuellement, un État unitaire concentré (Maroc)[20], centralisé (France)[21], décentralisé (Royaume-Uni)[22], ou régionalisé (Italie)[23]. Seulement si, lesdits États, consentent un jour, ce qui est peu probable, à devenir des États fédéraux, à l’instar de la Belgique, État régional, devenue, officiellement, depuis 1994, un État fédéral (art. 1er de la Constitution du 17 février 1994[24]). La fédéralisation s’entendrait aussi comme le degré de partage des compétences, asymétriques, mais solidaires, entre l’État fédéral déjà existant et les États fédérés qui le composent, à l’exemple aujourd’hui du Canada et ses provinces ou de la Suisse et ses cantons, de l’Allemagne et ses länder, de l’Australie ou des États-Unis d’Amérique et leurs États fédérés[25].
La création de l’Union fédérale du Canada, qui fut basée sur un compromis entre les deux principaux courants de pensée politique d’alors,[26]a été établie, sous l’égide de la couronne du Royaume-Uni, depuis la Loi constitutionnelle du 29 mars 1867, avec au départ les quatre provinces existantes à l’époque : l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et la nécessité d’admettre, par la suite, d’autres entités de l’Amérique du Nord britannique dans l’union (Préambule et art. 3-7 de la L.C. 1867)[[27]]url:jj . En effet, d’autres provinces furent rattachées à la fédération du Canada : le Manitoba (1870), la Colombie-Britannique (1871), l’Île-du-Prince-Édouard (1873), l’Alberta et la Saskatchewan (1905), et Terre-Neuve-et-Labrador enfin (1949) [[28]]url:jj . Les arrêtés royaux complétèrent le « touts-inclus » en transférant au Canada tous les territoires et possessions britanniques ainsi que les îles y adjacentes : terre de Rupert et territoire du Nord-Ouest (23 juin 1870), territoires de Yukon et de Nunavut (31 juillet 1880) [[29]]url:jj .
Le fédéralisme canadien est un modèle de politiques publiques, de gestion et d’administration de l’État du Canada de manière globale. Aussi, englobe-t-il, en effet, l’étendue des territoires sur lesquels règne sa souveraineté, les populations qui y vivent et les instances qui les gouvernent.
Le fédéralisme du Canada qui est composé d’un pouvoir fédéral et des pouvoirs fédérés, de dix provinces et trois territoires, s’étend sur une superficie avoisinant les dix millions de km2. Sans remonter jusqu’au Traité de Paris en 1763, début de délimitation des frontières nationales et internationales, [[30]]url:jj la seule frontière, en dehors des océans : Atlantique à l’est, Pacifique à l’ouest, Arctique au nord, demeurent les E.U.A au sud et l’Alaska au nord-ouest, qui est lui-même un État des E.U [[31]]url:jj . Sa géographie est vaste et diversifiée : hydrographie (océans, fleuves et lacs), montagnes, prairies, îles, forêts, ressources énergétiques et minérales ; et son économie aussi (services, agriculture, agroalimentaire, transports, industrie aéronautique, commerce extérieur, échange, exportation, investissement… [[32]]url:jj ).
Stimulée par une immigration permanente très élevée, la population canadienne dépasse aujourd’hui les 41 millions d’habitants, répartis inégalement entre provinces et territoires, très variée et caractérisée par une ethnicité très riche. Une population multiple origine qui a contribué à la richesse et au paysage ethnoculturel du Canada. On relèvera ainsi, selon les données statistiques, quelque 70% d’origine européenne [[33]]url:jj , plus de 16% d’origine Sud-Asiatique, Chinois et Noirs, plus de 6% d’origine autochtone (Indiens d’Amérique du Nord, Métis et Inuits [[34]]url:jj ), et 5% de musulmans, dont 1% arabe. Le reste de la population totale, c’est-à-dire un peu moins de 3%, est composé essentiellement d’une multitude d’ethnies, 242 au total, qui demeure tout de même, vu le nombre, une catégorie socioculturelle insignifiante démographiquement parlant [[35]]url:jj .
Aussi l’ensemble et la structure des finances publiques du Canada, fédérales et provinciales, (ressources, dépenses, gestion, cadre budgétaire et comptable et une péréquation fiscale verticale et horizontale), puisent leurs forces et consistance dans toutes ces richesses, gisements et potentialités océanographies, géographiques, géologiques et démographiques [[36]]url:jj .
Les différents échelons du fédéralisme canadien caractérisés par une souplesse, une collaboration et une perméabilité singulières, se présentent comme suit : le pouvoir exécutif est composé de la couronne britannique, le Roi pouvoir exécutif, depuis le décès de la Reine Élisabeth le 8 septembre 2022, représenté au niveau central ou fédéral par le gouverneur-général et le Conseil Privé du Roi, pour le Canada, et le gouvernement du Canada, et au niveau fédéré par les lieutenant-gouverneurs au nom du Roi, et les gouvernements fédérés (pouvoir exécutif des provinces et territoires).
Le pouvoir législatif est composé du Roi, pouvoir législatif, d’une chambre haute appelée le Sénat, 105 sénateurs, avec la possibilité pour la couronne britannique d’augmenter, dans certains cas, le nombre de sénateurs de 4 à 8, sans toutefois que le nombre total n’excède 113 sénateurs nommés à vie, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la retraite à 75 ans. Le gouverneur-général représentant de la couronne au Canada, députera (ou mandatera) des représentants au Sénat au nom du Roi. La Chambre des Communes est composée de 308 députés, sur un mandat de 5 ans, et le gouverneur-général, en sa qualité d’autorité législative, siège au nom de la couronne. Les représentants et sénateurs des dix provinces et trois territoires sont numériquement inégalement répartis au sein du Parlement fédéral (Loi constitutionnelle de 1867, révisée).
Au niveau fédéré, on relèvera le pouvoir législatif - ou la législature des provinces et des territoires - qui se compose du lieutenant-gouverneur et une seule chambre appelée Assemblée législative des provinces et des territoires, pour un mandat de quatre ans, ou de cinq ans pour les Assemblées de la Nouvelle-Écosse et du Yukon. Seule la législature du Québec est composée - outre le lieutenant-gouverneur représentant de la couronne- de deux chambres : le Conseil législatif du Québec et l’Assemblée législative du Québec. Les membres du Conseil législatif sont des sénateurs nommés à vie par le lieutenant-gouverneur (Loi constitutionnelle de 1867 révisée), au nom du Roi, depuis la mort de la Reine.
Le pouvoir judiciaire qui est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, départage légitimement ses attributions, ses compétences et les matières objets du contentieux, selon les différents niveaux institutionnels qui le composent et qui sont respectivement dépositaires d’une parcelle de l’autorité judiciaire conformément à l’étendue de son territoire. Ainsi, à l’échelle de l’Empire britannique au Canada, se situe la couronne, autorité judiciaire, en la personne du gouverneur général. À l’échelle fédérale proprement dite, se situent la Cour suprême, la Cour fédérale, la Cour d’appel de la Cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt et les Commissions et Tribunaux administratifs fédéraux.
À l’échelle provinciale et territoriale se placent les Cours d’appel provinciaux et territoriaux, les Cours supérieures provinciales et territoriales, et les Cours provinciales et territoriales. À l’échelle des subdivisions administratives territoriales et électorales les districts qui comprennent les comtés, les divisions de comtés, les villes, les townships, les cités et les villages, se situent les Tribunaux de l’aménagement du territoire, les Tribunaux de famille, les Tribunaux pour adolescents, la Cour des petites créances et la Cour de succession [[37]]url:jj .
Le pouvoir judiciaire provincial (judicature), système juridique dualiste fonctionnant par la commun Law, système anglophone, et le droit civil, système francophone, relève de la compétence du gouverneur-général : cours supérieures, district et comté, pour tout ce qui concerne la nomination des juges, leur révocation, leur salaire, ou la création, le maintien et l’organisation d’une Cour générale d’appel pour le Canada. Les juges des Cours supérieures sont choisis parmi les membres des barreaux de chaque province, et restent en fonction jusqu’à l’âge de 75 ans révolus, à moins d’une révocation ou de décès, leurs salaires sont payés par le Parlement du Canada (Loi constitutionnelle de 1867, art. 96-101).
Aujourd’hui, le fédéralisme canadien, qui se veut asymétrique et solidaire, se situe dans des perspectives d’avenir toutes nouvelles, innovantes, et ambitionne d’instituer et de véhiculer, dans une approche comparative, un modèle servant d’exemple, un paradigme pour le Canada et pour d’autres fédérations ou États en devenir de l’être. Il se conçoit comme un régime de coopération entre les différents paliers du pouvoir, un système de péréquation horizontale et verticale, soucieux de son histoire, de son économie, de l’environnement, des droits et des libertés de toutes les strates de la société qui le composent [[38]]url:jj , de toutes les composantes institutionnelles de son histoire, de sa culture, de son unité, de son identité [[39]]url:jj .
[[2]]url:jj - Que ce soit la Grande Charte des libertés de 1215 (la Magna Carta), l’organisation de la colonie de Nouvelle-France en 1663, ou la prise de l’Acadie par les Anglais en 1713, et la mainmise sur le Canada en 1763 ou encore les troubles politiques et les rébellions de 1837 et 1838, relatives à la loi des tenures du Canada et le régime seigneurial des terres au Bas-Canada (Québec), dont il était question de l’abolition, dénoncé comme système « suranné et oppressif » et de l’application du système « plus clément » aux terres et socage, ou plutôt l’anglicisation de la colonie, évinçant « l’évangélisation » établie auparavant, avaient une influence considérable sur l’évolution des Lois constitutionnelles révisées et du Canada lui-même, de 1867 à 1982 et bien après, v. Seguin M. (1947), Le régime seigneurial au pays de Québec, 1670-1854 (1er article), Revue d’histoire de l’Amérique française 1(3), 382-402, https://doi.org/10.7202/801387ar ; Joseph-Charles Taché, « De la Tenure Seigneuriale en Canada et projet de commutation », Québec, 1854, imprimé par Lovell et Lamoureux à leur Établissement à vapeur, sur la montagne, 63p.
[[4]]url:jj -L’histoire de la Constitution du Canada est un long processus d’actes, d’usages et de documents qui avait débuté en réalité depuis la Magna Carta au début du XIIIème siècle jusqu’à la Constitution de 1982, puis aujourd’hui encore avec ses différentes modifications, en passant, bien évidemment, par la première et officielle Constitution de 1867. Cf. J.-Y. Morin et J. Woehrling, Les constitutions du Canada et du Québec, du régime français à nos jours, t.1er, op.cit. 1994, 664 pages, pp.3 et s.123 et s.373 et s.401 et s.441 et s. Guy Tremblay, La portée élargie de la procédure bilatérale de modification de la Constitution du Canada, Revue générale de droit, 2011, 41(2), 417-449. https://doi.org/10.7202/1026929ar ; Gérald -A. Beaudouin et Pierre Thibault, La Constitution du Canada : Institutions, partage des pouvoirs, Charte canadienne des droits et libertés, Montréal, Wilson & Lafleur, 2004, 3e éd., pp.6-21, 1490 p. ; Wikipédia, Constitution du Canada.
[[6]]url:jj - Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), Digithèque MJP, du 14/07/2024, disponible sur le Web.
[[28]]url:jj -Digithèque, Constitution du Canada, 1999-2007.
[[31]]url:jj - Norman L. Nicholson, Frontières, l’Encyclopédie canadienne, du 6 février 2006, modifié le 4 mars 2015.



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 Codification, modification, fédéralisation : réflexions sur le corpus constitutionnel du Canada, approche méthodologique
Codification, modification, fédéralisation : réflexions sur le corpus constitutionnel du Canada, approche méthodologique