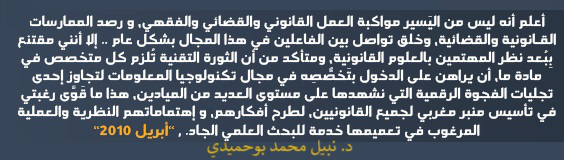télécharger l article

Title: The Architecture of Integrated Territorial Development
Abstract : This article analyzes the architecture of integrated territorial development inspired by the vision of His Majesty King Mohammed VI. It highlights the need for development focused on human well-being, participatory governance, and proactive territorial management. Centered on a citizen-based ecosystem with three pillars—human potential, opportunity creation, and multidimensional integration—it draws on the Social Vigilance experience in Khouribga to illustrate how inclusive and dynamic approaches foster resilient, sustainable local development.
Key words: Integrated territorial development, citizen-centered ecosystem, human potential, proactive governance, participatory management, social innovation, sustainable development, INDH, social vigilance
Résumé :
Cet article présente une analyse approfondie de l’architecture du développement territorial intégré, en s’inspirant des Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, telles qu’énoncées dans le Discours du Trône du 29 juillet 2025. Il souligne que le développement ne peut se limiter à des projets sectoriels ou infrastructurels, mais doit avant tout s’ancrer dans la valorisation de la condition humaine, à travers l’instauration d’une nouvelle génération de programmes de développement territorial intégré conçus pour dépasser les approches classiques fragmentées, promouvoir une gouvernance co-constructive et assurer une gestion proactive des dynamiques territoriales, tout en réduisant les disparités sociales et spatiales et en garantissant un accès équitable aux bénéfices du développement pour l’ensemble des citoyens, indépendamment de leur statut ou de leur localisation géographique.
Cette conceptualisation montre que le développement s’articule autour d’un écosystème citoyen, structuré autour de trois piliers fondamentaux: la valorisation de l’humain, la transformation des tensions socio-économiques comme leviers d’opportunités, et l’interconnexion des sphères sociale, économique et environnementale.
A cet égard, le présent article vise à expliciter les mécanismes opérationnels permettant de traduire en actions concrètes les approches dynamiques de développement territorial intégré, résilient et durable, en s’appuyant sur une expérience modeste mais significative menée dans la province de Khouribga dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement, intitulée Vigilance Sociale, initiée en 2021, qui a érigé la condition humaine en point de départ du processus de développement.
Mots-clés : développement territorial intégré, écosystème citoyen, gestion proactive, gouvernance co-constructive, approches dynamiques, INDH, condition humaine, vigilance sociale.
Introduction
Tout processus de développement, que ce soit une stratégie, un plan ou un programme ne peut se limiter à la réalisation de projets sectoriels ou à la simple construction d’infrastructures. Il doit trouver sa légitimité dans la condition humaine et viser prioritairement l’amélioration des conditions de vie des citoyens. Cette approche s’inscrit pleinement dans les Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, telles qu’exprimées dans le Discours du Trône du 29 juillet 2025 :
« Aucun niveau de développement économique et infrastructurel ne saurait Me contenter s’il ne concourt pas effectivement à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, de quelque frange sociale et de quelque région qu’ils appartiennent. »
Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le préserve a ainsi souligné la nécessité de passer des canevas classiques du développement social à une approche fondée sur le développement territorial intégré.
A cet effet, ce passage requiert la mise en place de programmes structurants, articulant de manière cohérente les dimensions sociale, économique et environnementale, et favorisant l’implication coordonnée des administrations, des collectivités territoriales, des citoyens, du secteur privé et des institutions académiques, afin de créer des synergies efficaces et durables.
Dans ce contexte, la question fondamentale qui se pose consiste à déterminer Comment concevoir et mettre en œuvre des programmes de développement territorial intégré, structurés autour d’un écosystème citoyen opérationnel, qui favorisent l’engagement collectif de l’ensemble des acteurs territoriaux, tout en garantissant une gouvernance co-constructive, la réduction des disparités sociales et spatiales, ainsi que la durabilité des actions entreprises ?
1-Le citoyen au cœur du développement territorial intégré
Le développement territorial intégré se définit comme une approche globale qui dépasse la simple accumulation de richesses matérielles pour placer l’humain au centre des dynamiques de changement territorial. En effet, dans un monde marqué par les transitions socioéconomiques incertaines et les défis environnementaux persistants, l’être humain apparaît à la fois comme levier et finalité du développement.
Cette approche prend une résonance particulière dans le contexte marocain, où les Orientations Royales réaffirment avec constance la primauté du capital humain comme pilier de l’Etat social et garant de la justice territoriale. Ainsi, cette Vision Royale constitue le fondement d’une dynamique territoriale inclusive, dans laquelle la centralité de l’humain justifie la participation citoyenne et l’innovation locale.
Dans ce cadre, le présent chapitre propose d’analyser la centralité de l’humain dans le développement territorial selon trois axes complémentaires. D’une part, il examine la notion de capital humain, en mettant en évidence l’articulation entre citoyens et territoires comme levier essentiel de la co-construction territoriale. D’autre part, il considère les tensions socio-économiques non pas comme des entraves, mais comme des catalyseurs de transformation et d’innovation sociale. Enfin, il présente la structuration du développement intégré autour de trois sphères interdépendantes ; sociale, économique et environnementale dont l’articulation constitue la clé pour bâtir un développement à la fois inclusif et durable.
1.1 Citoyen et territoire : des vies, des lieux et des liens
« Il n’est de richesse que d’Hommes » . Cette citation souligne que la vraie richesse d’une société réside dans son capital humain, lequel ne se limite pas à des ressources économiques, mais englobe également des composantes sociales, politiques et culturelles façonnant les trajectoires individuelles et collectives.
Ainsi, le capital humain comprend non seulement savoirs, compétences, talents et expériences, mais également la capacité à coopérer, innover et s’adapter. Dès lors, son développement requiert un engagement stratégique soutenu dans l’éducation, la santé, la culture, l’inclusion et la participation civique, autant de leviers déterminants pour renforcer la dynamique globale de la société.
De ce fait, cette approche dépasse le paradigme d’un développement exclusivement matériel, en plaçant l’humain à la fois comme finalité et levier de transformation territoriale.
Par ailleurs, comme le souligne Amartya SEN (1999) , le développement ne se réduit pas à la croissance économique : il vise à élargir les libertés réelles des individus, leur permettant de mener la vie qu’ils valorisent et de participer activement aux processus décisionnels et sociaux qui structurent leur environnement.
Cette perspective met en lumière le rôle du capital humain non seulement comme ressource productive, mais aussi comme vecteur d’émancipation, de résilience et d’innovation sociale, contribuant à l’adaptabilité des sociétés face aux transitions socioéconomiques et aux enjeux environnementaux.
De manière complémentaire, Friedmann , à travers sa théorie du développement régional intégré, insiste sur le rôle structurant des citoyens dans la transformation territoriale. Il conceptualise le citoyen comme un acteur central, capable d’influencer et de co-construire les dynamiques économiques, sociales et spatiales de son territoire.
Dans le contexte marocain, les Orientations Royales renforcent cette perspective. Lors de son discours du 29 juillet 2025, Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste affirme que « le Maroc n’a pas de place pour un développement à deux vitesses », soulignant l’importance de placer l’humain au centre des politiques publiques et de promouvoir une justice sociale renforcée. Cette approche favorise l’émergence d’un écosystème de co-construction, dans lequel citoyens et territoires interagissent activement, participant à un développement territorial intégré fondé sur une interaction dynamique entre l’humain et son espace.
Le premier constitue le levier du processus de développement, tandis que le second en représente le cadre structurant, englobant les pratiques sociales, économiques, politiques et culturelles. En conséquence, le territoire ne se réduit pas à sa matérialité : il reflète aussi les pratiques, les échanges et les relations de pouvoir qui structurent la vie sociale.
Selon Raffestin, le territoire est un espace produit par des rapports de pouvoir, des flux d’échanges et des dynamiques culturelles. Il est à la fois matériel et symbolique, reflétant les interactions entre acteurs et institutions .
Autrement dit, le territoire peut être appréhendé selon diverses dimensions complémentaires. D’une part, le territoire institutionnel renvoie aux frontières administratives et politiques qui organisent la gouvernance et la régulation de l’action publique, alors que le territoire expérientiel ancre dans les expériences subjectives, les liens identitaires et la mémoire collective des habitants .
D’autre part, le territoire fonctionnel structure les activités économiques, les mobilités et la circulation des ressources. A ces dimensions s’ajoute le territoire numérique, façonné par les réseaux sociaux et les plateformes en ligne, qui constitue un nouvel espace de représentation citoyenne. Cet espace dématérialisé traduit les opinions, les mobilisations et les dynamiques collectives, qu’elles relèvent d’initiatives constructives telles que les projets collaboratifs et l’innovation sociale, ou de pratiques disruptives telles que les incivilités numériques, les contestations et la polarisation sociale.
Ainsi, ces différentes dimensions révèlent que le territoire dépasse sa simple matérialité physique pour devenir à la fois support et produit des pratiques citoyennes ainsi que des représentations sociales. L’espace y est investi de perceptions, de valeurs et d’actions qu’il s’agisse d’aménagement, de préservation ou de dégradation qui orientent à leur tour les comportements et façonnent l’imaginaire collectif. Il n’existe ainsi ni citoyenneté sans ancrage territorial, ni vitalité territoriale sans implication citoyenne.
En ce sens, l’engagement citoyen peut être distingué en deux grandes catégories. La première regroupe les acteurs actifs et constructifs ; citoyens collaboratifs et producteurs qui participent pleinement à la co-construction territoriale en mobilisant leurs savoirs, expertises et ressources dans la mise en œuvre et le suivi des projets, générant des valeurs sociales et économiques. La seconde catégorie inclut les citoyens passifs ou critiques, dont le rôle se limite à observer ou commenter, influençant de manière ambivalente les représentations sociales.
De surcroît, ces acteurs interagissent au sein d’écosystèmes de réseaux, d’initiatives communautaires et d’espaces numériques. Lorsque l’engagement est constructif, ces configurations favorisent la valorisation des espaces partagés, la récupération des lieux et le renforcement des liens sociaux, à l’image des quartiers urbains, douars et villages agissant comme de véritables Living Labs .
A l’inverse, elles peuvent générer des dynamiques disruptives, telles que la polarisation sociale ou l’émergence d’incivilités. Il en résulte que, l’efficacité des écosystèmes citoyens dépend de leur aptitude à orienter positivement l’engagement collectif et à réguler les effets potentiellement délétères.
En définitive, l’interaction entre citoyens et territoires indique que le développement territorial repose fondamentalement sur la centralité de l’humain, dont les dimensions cognitives, sociales et culturelles, représentent à la fois un levier et une finalité de la transformation territoriale. Ainsi, les savoirs, compétences, talents et expériences, combinés aux capacités de coopération, d’innovation et d’adaptation, permettent aux individus de co-construire leur environnement, de générer des valeurs sociales et économiques et de renforcer la résilience des territoires.
En somme, le territoire ne se limite pas à une matérialité physique ou administrative, mais intègre les dimensions institutionnelles, fonctionnelles, expérientielles et numériques, reflétant les pratiques citoyennes, les relations de pouvoir, les échanges socio-économiques et les représentations collectives. Cette dialectique met en évidence que la vitalité territoriale dépend directement de l’engagement citoyen et que la citoyenneté s’épanouit toujours dans un ancrage territorial concret et symbolique.
Par ailleurs, les tensions et inégalités sociales ne constituent pas seulement des obstacles ; elles représentent également des indicateurs structurels de besoins insatisfaits et de dysfonctionnements territoriaux. De ce point de vue analytique, ces tensions peuvent être exploitées comme des leviers stratégiques de transformation et d’innovation sociale, à condition qu’elles soient rigoureusement identifiées, régulées et orientées vers des solutions collectives et inclusives.
Pour conclure cette section, reconnaitre le rôle du capital humain et l’interaction citoyen-territoire permet de concevoir le développement territorial comme un processus dynamique et résilient, où les tensions socio-économiques constituent à la fois des contraintes et des opportunités d’adaptation, de réorganisation et d’innovation sociale. Cette perspective prépare le passage au volet suivant, consacré aux inégalités et aux tensions socio-économiques en tant que facteurs de transformation territoriale et leviers de développement.
1.2 Inégalités socio-économiques : catalyseurs de transformation territoriale et leviers de développement
La centralité de l’humain et l’interaction entre citoyens et territoires, telles qu’analysées dans la section précédente, illustrent que le développement territorial repose essentiellement sur la participation active des citoyens et sur l’ancrage territorial. Toutefois, cette co-construction s’inscrit dans des contextes sociaux et économiques souvent marqués par des tensions, des déséquilibres et des inégalités, qui conditionnent la capacité des territoires à se développer de manière inclusive et durable.
Ces tensions socio-économiques qu’il s’agisse d’inégalités d’accès aux ressources, de vulnérabilités sociales ou d’incivilités urbaines et numériques constituent des déterminants essentiels influençant la cohésion territoriale.
Loin d’être de simples entraves, elles peuvent être considérées comme des leviers de transformation territoriale, révélant les besoins réels des citoyens et mettant en lumière les dysfonctionnements des modes de gestion.
Dans le contexte marocain, marqué par des politiques publiques orientées vers la justice sociale et le développement territorial intégré, ces tensions constituent des indicateurs stratégiques permettant d’adapter les stratégies de planification territoriale et de stimuler l’innovation sociale et territoriale.
Lorsqu’elles sont analysées et intégrées de manière proactive, ces tensions deviennent de véritables catalyseurs de transformation. Elles encouragent la réorganisation des modes d’action, le renforcement des mécanismes de solidarité et la conception de projets inclusifs, durables et porteurs de cohésion sociale. Par exemple, des initiatives locales de valorisation d’espaces publics dégradés, des programmes d’éducation civique et numérique, ainsi que des partenariats entre acteurs institutionnels et société civile, démontrent comment les tensions peuvent être converties en opportunités de progrès territorial.
Au-delà de leur rôle comme obstacles ou catalyseurs, ces inégalités socio-économiques constituent également un outil analytique pour comprendre la structure et les dynamiques territoriales. Elles permettent un ciblage temporel, spatial et comportemental, en identifiant les zones et les acteurs concernés, ainsi qu’en repérant les interactions et dynamiques à risque liées aux tensions socioéconomiques et environnementales.
Dans ce cadre, le territoire, envisagé comme un espace matériel, symbolique et expérientiel, devient à la fois support et produit de ces interactions, où les citoyens participent activement à sa transformation et à son développement.
Premièrement, le ciblage temporel consiste à analyser la dimension chronologique des tensions socio-économiques. Cette approche permet de détecter les périodes critiques (crises sanitaires, catastrophes naturelles ou crises économiques saisonnières affectant l’agriculture) et de planifier des interventions proactives en infrastructures, services publics et dispositifs de solidarité. En parallèle, des phénomènes sociaux ponctuels, tels que les migrations ou les mobilisations collectives, accentuent ces tensions temporelles.
Deuxièmement, le ciblage spatial met en évidence la répartition géographique des inégalités et tensions. Certaines zones urbaines périphériques, quartiers, douars ruraux concentrent des populations précaires et souffrent d’un déficit d’infrastructures et de services essentiels.
Les tensions spatiales se concrétisent par la dégradation urbaine des espaces publics, l’accumulation de déchets ou la précarité des équipements collectifs. Cette approche permet d’identifier les zones prioritaires pour l’action publique, de planifier des aménagements intégrés et de restaurer le lien social, tout en orientant les politiques de développement territorial intégré.
Troisièmement, le ciblage comportemental analyse les pratiques individuelles et collectives. Il distingue les comportements constructifs (participation citoyenne, engagement civique, innovation sociale) et des comportements perturbateurs (violence, incivilités numériques ou polarisation sociale, ensauvagement urbain ).
A cet égard, l’étude menée par le Centre marocain pour la citoyenneté révèle que ces dynamiques traduisent à la fois des changements de mentalité et la frustration engendrée par les inégalités, tout en soulignant des politiques publiques sur la régulation sociale.
D’après cette étude, l’analyse comportementale constitue un mécanisme essentiel pour identifier les leviers favorisant la coopération citoyenne et, par conséquent, de renforcer la résilience territoriale.
Ces trois dimensions ; temporelle, spatiale et comportementale sont complémentaires, Ainsi, la dimension temporelle permet d’appréhender l’évolution des dynamiques sociales, économiques et environnementale, parallèlement, la dimension spatiale éclaire la distribution et l’organisation des ressources, infrastructures et pratiques ; enfin, la dimension comportementale révèle les choix, interactions et stratégies des acteurs impliqués.
La coordination de ces trois dimensions engendre l’émergence de synergies dans lesquelles les interventions publiques, les initiatives privées et les mobilisations citoyennes convergent pour transformer les défis socio-économiques en leviers de progrès territorial. Ces synergies renforcent directement la résilience et la durabilité des écosystèmes locaux.
En outre, ces effets se traduisent concrètement dans les trois sphères sociale, économique et environnementale qui structurent les dynamiques de développement territorial. La section suivante analysera ces sphères afin de démontrer leur interaction et leur articulation dans la mise en œuvre opérationnelle du développement territorial intégré.
1.2 Sphères sociale, économique et environnementale : structuration et articulation des dynamiques territoriales
Les sphères sociale, économique et environnementale constituent le socle des dynamiques territoriales, sur lequel repose tout processus de développement. Leur articulation permet de dépasser les approches classiques et sectorielles pour instaurer un écosystème intégré, centré sur l’humain et aligné avec les Orientations Royales en faveur d’un Etat social résilient.
Cette conception s’inscrit dans la continuité des théories contemporaines du développement territorial, qui mettent en lumière la nécessité d’intégrer simultanément ces trois dimensions pour produire des dynamiques cohérentes, innovantes et durables .
Primo : la sphère sociale
La sphère sociale constitue le fondement du développement territorial. Elle englobe non seulement les services essentiels tels que l’éducation, la santé et la protection sociale, mais également l’analyse des comportements civiques, des réseaux de solidarité et des mécanismes de mobilisation citoyenne .
Cette perspective, éclairée par les travaux d’Amartya Sen sur le développement humain et la liberté , met en évidence que le bien-être et l’inclusion sociale ne peuvent être dissociés de la participation citoyenne effective. Autrement dit, la cohésion sociale et la résilience territoriale reposent sur la capacité des individus à agir collectivement et à s’engager dans la construction de leur avenir commun.
Dans l’espace réel, la sphère sociale se traduit par la participation aux instances locales, l’engagement associatif, le développement de projets communautaires et la valorisation des espaces publics. Ces interactions incarnées permettent aux citoyens de se sentir acteurs de leur territoire, renforçant le lien social et la cohésion territoriale. En effet, le capital social, constitué des réseaux de confiance et de coopération, est un déterminant majeur de la réussite des politiques publiques et de la résilience des communautés . Toutefois, certaines fragilités persistent : marginalisation, repli communautaire ou inégalités d’accès aux services essentiels, nécessitant des dispositifs inclusifs et adaptatifs.
Dans l’espace numérique, la sphère sociale s’étend à de nouvelles formes de participation et de construction citoyenne. Dans l’espace numérique, la sphère sociale s’étend à de nouvelles formes de participation et de construction citoyenne. Les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives favorisent la participation communautaire à des projets territoriaux, à des campagnes de sensibilisation à l’environnement, ainsi qu’à des dispositifs de formation à distance.
Néanmoins, ces plateformes numériques risquent également d’amplifier des phénomènes négatifs tels que la désinformation, la polarisation ou les comportements antisociaux, comme en témoignent les débats autour des fake news et des mouvements de contestation en ligne.
Ces dérives mettent en évidence la nécessité d’une éducation citoyenne adaptée aux usages numériques, afin de garantir que l’engagement virtuel se traduise par des effets positifs sur le territoire et la cohésion sociale.
L’interaction entre espace réel et numérique structure aujourd’hui la citoyenneté contemporaine. A cet effet, les initiatives positives en ligne peuvent catalyser des actions concrètes sur le terrain, Alors que, les tensions numériques peuvent se répercuter dans la réalité sociale. Par conséquent, la complémentarité des deux dimensions devient un facteur déterminant pour la cohésion socio-territoriale et la durabilité des projets sociaux .
Les situations critiques qu’elles soient sanitaires, climatiques ou économiques ont démontré que la résilience des territoires repose sur la coopération des institutions avec et pour les citoyens, ainsi que sur l’intégration de solutions inclusives et participatives.
De fait, l’engagement actif des citoyens et la responsabilité des institutions, tant sur le terrain que via les plateformes numériques, constituent un levier essentiel pour anticiper les crises et renforcer la confiance envers les institutions .
Globalement, la sphère sociale associant services essentiels, participation citoyenne et capital social, souligne la nécessité de dispositifs inclusifs et adaptatifs. De plus, la complémentarité entre interactions concrètes et numériques s’avère déterminante pour co-construire des programmes capables de s’adapter aux défis contemporains.
Secundo : la sphère économique
La sphère économique s’impose comme un vecteur stratégique du développement territorial, en générant non seulement les ressources et infrastructures nécessaires, mais également les opportunités qui soutiennent les initiatives locales et renforcent la cohésion et l’équité territoriale.
Notamment, elle ne se limite pas à la production de richesses ; elle englobe un ensemble de secteurs interconnectés, incluant l’économie du savoir, de la culture, de la santé, de la protection sociale, du sport et l’économie circulaire. Cette pluralité sectorielle permet de créer des opportunités durables et d’accroître la productivité des territoires, tout en consolidant leur résilience face aux aléas sociaux et environnementaux.
Par ailleurs, les composantes de cette sphère se caractérisent par une interdépendance structurelle. La compétitivité territoriale favorise la valorisation des ressources locales et l’attractivité des investissements, tandis que l’entrepreneuriat constitue un catalyseur d’innovation et de création d’emplois. De surcroît, le développement des chaînes de valeur locales intègre les acteurs économiques à différents niveaux, renforçant ainsi la capacité des territoires à absorber les fluctuations des marchés.
L’intégration coordonnée des secteurs stratégiques contribue à la stimulation des dynamiques locales et à la consolidation de l’identité territoriale.
A ce propos, l’économie de la santé, de la protection sociale et du sport agit directement sur la productivité et le bien-être collectif. Parallèlement, les initiatives d’économie sociale et solidaire établissent des liens fonctionnels entre les actions locales et les projets structurants à grande échelle.
En somme, l’articulation de la sphère économique avec les sphères sociale et environnementale engendre un cercle vertueux : la croissance économique soutient les initiatives sociales et écologiques, lesquelles renforcent à leur tour la cohésion territoriale, la durabilité et l’équité. Ainsi, l’investissement dans des infrastructures vertes, des centres culturels ou des projets agro-industriels durables illustre concrètement cette interdépendance et souligne la nécessité d’une approche intégrée et systémique du développement territorial
Tertio : la sphère environnementale
La sphère environnementale constitue le pilier de la durabilité et de la résilience écologique. Elle suppose une gestion rationnelle et proactive des ressources naturelles, en particulier de l’eau, afin de faire face au stress hydrique et au changement climatique. Elle englobe la préservation de la biodiversité, la lutte contre la dégradation des sols et la régulation des pollutions, garantissant ainsi la durabilité des écosystèmes locaux .
Dans ce cadre, la gestion durable de l’eau revêt une importance stratégique pour l’agriculture, l’industrie et les usages domestiques . L’intégration de pratiques écologiques dans les projets territoriaux constitue non seulement une nécessité environnementale, mais également un facteur de résilience socio-économique.
D’autre part, les comportements citoyens représentent un facteur déterminant dans l’efficacité des politiques écologiques : la réduction de la consommation d’eau, le recyclage, la protection des espaces verts et la participation à des initiatives collectives renforcent simultanément la cohésion sociale et la durabilité environnementale. Ainsi, la sphère environnementale conditionne la pérennité des initiatives économiques et sociales, établissant un cercle vertueux où chaque sphère contribue au développement intégré des territoires
De plus, l’interaction des trois sphères met en lumière une logique systémique : d’une part, la sphère sociale assure la cohésion indispensable aux investissements ; d’autre part, la sphère économique génère les ressources qui soutiennent les initiatives sociales et environnementales ; en outre, la sphère environnementale garantit la durabilité des ressources et la résilience des territoires. Par conséquent, ce modèle transforme les citoyens de simples bénéficiaires en acteurs engagés, créateurs de valeur et partenaires actifs dans la reconstruction territoriale.
Pour clore cette section, la déclinaison opérationnelle de ce modèle sera présentée dans le chapitre suivant, démontrant ainsi comment ces dynamiques se traduisent concrètement en programmes et en écosystèmes intégrés.
Chapitre 2 : Déclinaison opérationnelle du développement territorial intégré.
Ce chapitre s’inscrit dans la continuité opérationnelle de la section précédente, qui a posé les fondements conceptuels du développement territorial intégré. Il propose désormais une déclinaison concrète de ces dynamiques, en mettant en lumière les mécanismes permettant de transformer les approches en programmes intégrés et résilients, tout en illustrant comment la condition humaine devient un levier de la transformation socio-territoriale et de l’écosystème citoyen, en s’appuyant sur l’expérience modeste mais significative de la province de Khouribga.
Celle-ci a placé la condition humaine au cœur du processus de développement social, faisant du citoyen non seulement un bénéficiaire, mais également un acteur déterminant de la transformation socio-territoriale.
Le chapitre suivant mettra en évidence l’ossature opérationnelle de ce processus, en soulignant les modes de gestion qui ont permis de faire de la condition humaine le socle d’un écosystème inclusif. Il révèle également la capacité de cette expérience à produire des solutions pratiques et réalistes, répondant aux problèmes locaux des citoyens et satisfaisant leurs besoins légitimes et attentes raisonnables en matière de protection sociale, de santé, d’éducation et d’insertion socio-économique.
L’expérience de la province de Khouribga s’articule autour de trois axes principaux, étroitement liés et complémentaires. Le premier concerne la gouvernance co-constructive, fondée sur une architecture triptyque « Accueil, Incubation, Inclusion », qui établit le fondement d’une dynamique collective et participative. Ce cadre structurant prépare le terrain pour la mise en œuvre de la gestion proactive.
Le deuxième axe concerne la gestion proactive, qui s’appuie sur la gouvernance co-constructive et agit comme facilitateur, accélérateur et catalyseur, le rôle des acteurs locaux pivots y étant central, avec des modèles de gestion intégrative. Cette démarche transforme les espaces administratifs en lieux d’échange et d’innovation, instaurant un management constructif qui assure la pertinence et l’efficacité des programmes.
Le troisième axe, le passage du citoyen bénéficiaire au citoyen producteur, constitue l’aboutissement logique des deux premiers axes. Grâce à une gouvernance co-constructive et à une administration proactive, les citoyens deviennent des acteurs productifs et responsables au sein d’un écosystème inclusif et durable, renforçant ainsi la résilience territoriale.
Ainsi, ces trois axes ne fonctionnent pas isolément, mais se renforcent mutuellement : la gouvernance co-constructive établit le cadre, la gestion proactive le met en œuvre, et le citoyen producteur en est le résultat tangible.
En conséquence, les sections suivantes détailleront ces axes en profondeur, en révélant les bonnes pratiques qui ont permis de traduire les dynamiques socio-territoriales en un écosystème opérationnel inclusif et résilient.
2.1 Gouvernance co-constructive : Repenser l’action territoriale
Dans un contexte territorial en profonde mutation, où les défis économiques, sociaux et environnementaux se croisent et s’amplifient, les territoires se trouvent confrontés à des problématiques inédites.
Les approches classiques de gouvernance montrent leurs limites face à l’exigence croissante de solutions inclusives et adaptées aux réalités locales, rendant nécessaire le dépassement d’une gouvernance verticale au profit d’un modèle où la co-création de solutions avec les citoyens devient centrale, mobilisant écoute, coopération et intelligence partagée, et favorisant la construction collective de réponses adaptées et durables.
Dans cette perspective, la gouvernance co-constructive s’affirme comme une approche intégrative, centrée sur l’humain, ses besoins et son potentiel, transformant les défis en leviers d’action et les contraintes en opportunités de développement. Cette approche place l’action locale au cœur du processus décisionnel, renforçant la résilience territoriale et la capacité d’adaptation face aux mutations et aux changements multiples.
Sous cet angle, le modèle de la province de Khouribga témoigne de la capacité des territoires à transformer les tensions socio-économiques en leviers de progrès. Elle illustre concrètement comment les principes du développement intégré peuvent se traduire en actions et programmes concrets, renforçant l’Etat social et favorisant un développement inclusif et durable.
Corrélativement, cette démarche se concentre sur une conception de solutions pratiques et réalisables aux problèmes réels des citoyens, en apportant des réponses adaptées à leurs besoins et attentes légitimes en matière de protection sociale, de santé, d’éducation ou d’emploi.
Cette initiative s’inscrit dans les Orientations définies par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, telles qu’énoncées dans son Discours Royal à l’occasion de la fête du trône, le dimanche 29 juillet 2018:
« Cher peuple, la question sociale retient toute Mon attention et M’interpelle vivement, à la fois en tant que Roi et en tant qu’homme. Depuis Mon accession au Trône, J’ai toujours été à l’écoute de la société et prompt à cerner ses attentes légitimes. Constamment à l’œuvre, Je porte l’espoir inaltérable d’améliorer les conditions de vie des citoyens ».
Conformément aux Hautes Orientations Royales, l’Autorité Gubernatoriale a mis en place un arsenal de mécanismes pour élaborer un projet inclusif en faveur de la société, dans une convergence étroite et encadrée. Elle implique une large panoplie d’acteurs de l’ingénierie sociale, présents dans chaque commune, quartier et douar, afin de participer à un processus de co-construction avec les citoyens.
Ce projet fonctionne comme un écosystème social inclusif, où l’accueil des citoyens dépasse la simple formalité administrative pour devenir un processus vivant et interactif, favorisant l’expression des idées de chacun ainsi que de leurs besoins et attentes légitimes.
2-1-1-Vigilance sociale : Agir Ensemble Autrement
Le projet de Vigilance Sociale a été lancé dans le cadre de l’INDH, le 5 octobre 2021, en étroite collaboration avec l’association provinciale, le parquet général, la sûreté nationale, la gendarmerie royale, la protection civile, ainsi que les services sectoriels de l’éducation, de la santé, de la jeunesse, de la culture et du sport. Ce dispositif implique les associations locales intervenant dans les domaines de la protection sociale, de la santé, de l’insertion socio-éducative et socio-économique, afin de créer un écosystème social inclusif et coordonné, au service des populations précaires : femmes en situation difficile, enfants abandonnés, personnes âgées isolées, sans-abri, mineurs non scolarisés, jeunes NEET(Not in Education, Employment, or Training) indépendamment de leur origine ou de leur nationalité.
De surcroît, la vigilance sociale dépasse la simple gestion de l’urgence. Elle repose sur un diagnostic social rigoureux, l’écoute active, l’orientation et la mise en place de réponses adaptées, transformant les tensions en leviers de résilience sociale. Cette approche se distingue par son anticipation et son adaptabilité, permettant non seulement d’identifier et de prévenir les situations critiques, mais aussi de générer des solutions innovantes et adaptées à chaque situation. L’ossature du dispositif s’articule autour de cinq pôles complémentaires : accueil et hébergement, pôle médical, pôle juridique, pôle socio-éducatif et pôle socio-économique, constituant ainsi un continuum d’accompagnement intégré.
Depuis Octobre 2021 jusqu’à mai 2025 , plus de soixante mille interventions ont été effectuées, bénéficiant tant aux populations locales en situation de précarité qu’aux personnes provenant d’autres villes ou d’autres nationalités, notamment aux passagers requérant un accompagnement dans des situations critiques. Ainsi, ces actions ont contribué de manière significative au renforcement de la cohésion sociale, démontrant de manière concrète le lien entre efficacité opérationnelle, créativité et impact humain.
En outre, ces interventions feront l’objet d’un futur livret qui racontera les récits de transformation des vies, des liens et des lieux, permettant ainsi de découvrir les changements profonds qu’elles ont engendrés.
Par ailleurs, ce dispositif fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, selon un processus structuré : réception des signalements sur le terrain ou via les réseaux sociaux, collecte et analyse des données, diagnostic social, identification des mécanismes d’intervention, coordination avec les parties prenantes, puis orientation vers des prises en charge adaptées.
Cette organisation illustre parfaitement que proactivité et réactivité peuvent coexister afin de produire une inclusion durable, qu’elle soit médicale, socio-économique, éducative, juridique ou psychologique.
De l’urgence à l’inclusion
Chaque cas identifié, qu’il soit signalé par un appel téléphonique, relayé sur les réseaux sociaux ou constaté directement sur le terrain mobilise immédiatement la Cellule de Vigilance Sociale. Que la situation concerne une femme en difficulté, une personne atteinte de troubles mentaux, un enfant abandonné, un sans-abri, une personne âgée isolée, une jeune fille non scolarisée ou un jeune NEET en errance, la réponse se veut rapide, adaptée et créative, respectant les besoins spécifiques de chaque situation qui fait l’objet d’interventions spécifiques : prise en charge médicale d’urgence, assistance sociale, hébergement temporaire, orientation éducative, réinsertion professionnelle, accompagnement socio-éducatif, regroupement familial ou formation professionnelle.
Dès le premier contact, des actions concrètes sont déclenchées : transfert à l’hôpital (soins médicaux ou chirurgicaux), douche, nettoyage du domicile, changement de vêtements, repas, accompagnement psychologique, orientation juridique, insertion socio-économique et consolidation du capital humain.
Ces interventions sont coordonnées de manière collaborative par la Cellule, en synergie étroite et structurée avec le parquet général, la sûreté nationale, la gendarmerie royale, les autorités locales ainsi que les services de santé et les associations partenaires assurant la continuité de l’accompagnement, renforçant ainsi le réseau de soutien territorial et la cohésion sociale.
En définitive, l’objectif du dispositif est de passer de l’urgence à l’inclusion, en construisant avec chaque bénéficiaire son projet de vie, transformant les problèmes et les crises en leviers d’opportunité. La mission ne se limite pas à la gestion de crises ponctuelles, mais consiste à co-construire avec le citoyen des solutions collectives, durables et génératrices de cohésion sociale.
2-1-2-Architecture Triptyque : Accueil-Incubation-Inclusion
La gouvernance co-constructive s’affirme comme une réponse innovante aux limites des approches classiques de développement, plaçant l’humain, ses besoins et son potentiel au cœur des processus décisionnels, tout en combinant une approche territoriale intégrée incarnée par l’architecture triptyque « Accueil, Incubation, Inclusion » qui permet de transformer les besoins, tensions et vulnérabilités en opportunités de développement, tout en créant des synergies opérationnelles entre acteurs publics, associatifs et citoyens.
Accueil : instaurer la confiance et prévenir les tensions
Le processus débute par l’accueil, phase essentielle qui dépasse la simple réception des citoyens. Il constitue un mécanisme structurant d’écoute active, de reconnaissance et de valorisation des expériences, nécessaire pour instaurer un climat de confiance. Dans le cadre de la Cellule de vigilance sociale, chaque signalement, qu’il provienne du téléphone, des réseaux sociaux ou d’observations directes sur le terrain, déclenche un processus de traitement immédiat, illustrant concrètement l’efficacité de cette démarche.
Par ailleurs, l’accueil permet de légitimer les doléances et de prévenir les tensions sociales, tout en identifiant les besoins spécifiques et en préparant les actions d’incubation.
Dans une perspective d’ingénierie sociale, cette phase agit comme un capteur territorial, transformant perceptions, frustrations et aspirations des citoyens en données exploitables pour la conception de solutions adaptées. Ainsi, l’accueil se révèle être un espace d’hospitalité citoyenne où la parole devient une ressource et la condition humaine un socle fondamental de tout processus, programme ou projet.
Incubation : transformation des besoins légitimes en actions concrètes
L’incubation traduit les informations collectées, attentes légitimes et besoins identifiés en projets concrets, innovants et viables. Cette étape mobilise les fondements de l’ingénierie sociale afin de transformer les tensions en opportunités de développement participatif et co-créatif.
Concrètement, au sein du processus de vigilance sociale, l’incubation prend forme par la mise en œuvre de programmes d’initiatives locales, portés par la collaboration entre acteurs publics, associatifs et citoyens : la prise en charge socio-médicale des personnes âgées, des enfants abandonnés, l’accompagnement des jeunes non scolarisés vers la formation et l’emploi, la réinsertion socio-économique des femmes en situation difficile, ou la mobilisation d’incubateurs pour des projets agricoles et entrepreneuriaux.
L’incubation suit une logique systémique : les initiatives sont testées, ajustées et reproduites dès que leur impact social est confirmé. Cette approche permet de générer une valeur ajoutée tangible, en transformant la vulnérabilité en potentiel et en consolidant les liens entre acteurs locaux, institutions et communautés.
Inclusion : autonomisation et intégration socio-économique
L’inclusion représente la phase d’accomplissement du processus triptyque, en reliant l’accompagnement social à l’autonomisation et à l’intégration durable des bénéficiaires dans le tissu socio-économique.
Elle va au-delà du simple appui ponctuel pour renforcer les capacités, favoriser l’insertion socio-professionnelle et garantir l’accès équitable aux services éducatifs, sanitaires et économiques.
Par ailleurs, elle agit comme un levier de cohésion sociale, en intégrant les personnes en situation de précarité dans la dynamique de transformation territoriale. En valorisant les talents locaux et en stimulant les initiatives collectives, l’inclusion devient ainsi un moteur de solidarité et de durabilité, fondé sur la synergie entre acteurs publics, associatifs et citoyens.
En somme, l’architecture « Accueil – Incubation – Inclusion » représente la structure fondamentale de la gouvernance co-constructive dans la transformation des situations critiques en opportunités de développement, tout en consolidant la participation et la cohésion sociale. Cette approche intégrée ouvre la voie à la gestion proactive, dont les principes et mécanismes seront traités dans la section suivante.
2.2 Gestion proactive : Proagir ensemble
Si la gouvernance co-constructive définit le cadre structurant du processus de vigilance sociale basé sur l’Accueil, l’Incubation et l’Inclusion, la gestion proactive assure à la fois la mise en œuvre et la cohérence opérationnelle des interventions, des actions, des initiatives inclusives et aussi des programmes élaborés dans la province de Khouribga. Cet écosystème n’est pas figé : il se vit, s’expérimente et s’incarne au quotidien, à travers le contact direct avec les citoyens et l’organisation des équipes. Il ne se limite pas aux bureaux : il se déplace vers les citoyens pour écouter leurs besoins, comprendre leurs difficultés et co-construire des solutions adaptées.
Cette démarche managériale s’inscrit pleinement dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, qui a insisté sur la modernisation des méthodes de travail et l’ardeur créative dans la gestion de la chose publique.
« D’ailleurs, j’ai d’ores et déjà appelé à la nécessité de moderniser les méthodes de travail, de faire preuve d’ardeur créative et d’innovation dans la gestion de la chose publique. » .
Dans ce contexte, la gestion proactive devient un levier reliant politiques, programmes et projets aux besoins et attentes légitimes des citoyens. Elle irrigue le fonctionnement interne et externe et transforme les équipes administratives en collectifs dynamiques, où confiance, cohésion et créativité renforcent la performance et l’impact des actions.
Lors des réunions régulières, briefings et débriefings, les rôles et responsabilités sont systématiquement clarifiés, en précisant qui agit, quand, où, comment et avec qui. Ce processus commence par la posture symbolique « Qui accroche la cloche », prononcée par le responsable au lancement de chaque rencontre. Cette pratique incarne la cohésion, la coordination et l’engagement collectif, tout en rappelant à chaque membre de l’équipe son rôle actif, tant dans la dynamique du groupe que dans la réussite des projets territoriaux.
Ainsi, chaque fonctionnaire prend conscience de sa double fonction : celle de gestionnaire administratif et celle de citoyen engagé. Au-delà de l’exécution des tâches, cette méthode favorise l’écoute active, l’échange réflexif et la co-construction de solutions, établissant un réseau de cohésion managériale où les rôles de facilitateur, catalyseur, accélérateur, pivot se complètent et se renforcent mutuellement.
Cette approche de gestion s’appuie sur les directives royales définies par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie dans son discours du Trône, le 29 juillet 2017, visant à moderniser l’Administration et à renforcer l’efficacité au service des citoyens.
« il appartient donc au gouverneur et au caïd, au directeur et au fonctionnaire, ainsi qu’au responsable communal, etc., d’adopter les méthodes actives de travail et les objectifs ambitieux des cadres du secteur privé. Mus par le sens des responsabilités, ils doivent faire honneur à l’Administration, et aboutir à des résultats concrets. Car, en définitive, leur responsabilité est de veiller sur les intérêts des gens »
A la lumière de cette orientation, les réunions prennent une dimension essentielle, elles structurent un écosystème collaboratif, transformant les bureaux en laboratoires d’innovation sociale.
Grâce aux outils de Design Thinking , de prototypage et surtout de co-décision, chaque problématique sociale, sanitaire, éducative ou économique devient une opportunité d’action collective et d’innovation partagée.
En effet, l’enjeu dépasse largement la simple formation et relève d’un véritable changement de mentalités collectives, qui se traduit par la co-existence et l’interaction du fonctionnaire-citoyen et du citoyen-fonctionnaire.
« Le fonctionnaire-citoyen » est avant tout un citoyen, qui agit depuis sa position administrative avec conscience de ses responsabilités professionnelles tout en respectant les droits, les besoins et les attentes légitimes des citoyens. Il ne se limite pas à appliquer des procédures : il devient un acteur intégrant de manière systémique la dimension civique à son action et favorisant ainsi une gouvernance éthique, participative et proche des citoyens.
Parallèlement, le citoyen-fonctionnaire sur le terrain adopte une posture active et engagée, contribuant à la co-construction des politiques publiques et à la transformation des signaux sociaux en données d’action concrètes. Cette dynamique crée un écosystème de gouvernance intégrée, où l’interaction continue entre fonctionnaires et citoyens devient un levier de résilience, d’innovation sociale et de renforcement de la confiance, fondée sur la reconnaissance que tout fonctionnaire est d’abord un citoyen engagé.
Cette synergie s’incarne pleinement dans l’expérience de Vigilance Sociale , qui met en scène l’articulation vivante entre le terrain et l’administration. Le terrain ne se limite plus à un simple espace d’intervention pour devenir un véritable bureau de rencontre, un lieu où s’expriment les besoins, les attentes et les initiatives citoyennes. Quant à l’administration, elle dépasse sa fonction de gestion ou de décision pour se redéfinir en espace de rencontre, d’écoute et de co-construction.
La coordination s’opère aussi au sein du comité régional et des comités locaux chargés de la prise en charge des femmes et enfants victimes de violence , où le parquet général, la sûreté nationale, la gendarmerie royale, les autorités locales et les services d’éducation, de santé, de jeunesse, de sport, de culture, des affaires islamiques, l'Union Nationale des Femmes du Maroc et la société civile collaborent profondément.
Ces interventions intégrées visent à renforcer la cohésion socio-familiale, éducative et l’inclusion économique, tout en assurant orientation et sensibilisation proactive des bénéficiaires. Elles reposent sur la convergence immédiate des membres des comités à travers des réunions régulières et des groupes de travail thématiques, garantissant l’efficacité, la réactivité et la cohérence des interventions, et transformant les situations critiques en opportunités de développement inclusif et de renforcement du tissu social local.
Cette approche de gouvernance se complète avec le marketing relationnel et le marketing social. D’une part, le marketing relationnel favorise la confiance entre l’administration et les citoyens, transformant ces derniers en acteurs de la gouvernance.
D’autre part, le marketing social dépasse la relation individuelle pour modifier les comportements collectifs, avec la sensibilisation, l’éducation et la communication communautaire comme leviers pour encourager des pratiques conformes à l’intérêt général, telles que la protection de l’environnement, la prévention sanitaire, l’inclusion sociale et la participation civique.
Ces modes de gouvernance intégrative et collaborative instaurent un dialogue permanent, où adaptation et co-construction deviennent la norme. Chaque fonctionnaire, avant tout citoyen, entretient une relation vivante et responsable avec la société, transformant les besoins, les attentes légitimes et les défis en initiatives collectives et consolidant la résilience territoriale.
En définitive, gouverner consiste avant tout à écouter, accompagner, incuber, servir et inspirer : transformer les défis en opportunités, les besoins en projets et les initiatives en un futur commun. C’est dans cette optique que s’inscrit le troisième axe, consacré à la transformation du citoyen bénéficiaire en citoyen producteur, véritable clé de l’écosystème local et garant d’un développement inclusif et durable.
2.2 Eco-Citoyen : Du citoyen bénéficiaire au citoyen producteur
L’émergence du concept d’éco-citoyen traduit le passage d’un modèle de gouvernance centré sur la simple prestation à un modèle fondé sur la co‑production territoriale du bien commun.
Dans une perspective systémique, le citoyen cesse d’être un simple bénéficiaire des politiques publiques pour devenir un acteur actif, engagé dans l’action collective, la responsabilité intégrative partagée.
Cette approche s’inscrit dans le courant des théories de la gouvernance co-constructive, qui conçoivent le territoire comme un système vivant et un espace où se croisent les rationalités institutionnelles, sociales et affectives . Par conséquent, le développement y est envisagé comme un processus dialogique, associant institutions et communautés dans une logique d’interdépendance, d’ajustement continu et de co-apprentissage.
Le présent axe se concentre sur la transformation du citoyen bénéficiaire en citoyen producteur, véritable clé de voûte de l’écosystème local et garant d’un développement inclusif et durable. Dès lors, une question centrale émerge : comment cet écosystème fonctionne-t-il concrètement et comment peut-il articuler efficacement les programmes territoriaux intégrés et l’engagement citoyen ?
Le développement territorial intégré ne peut se réduire à une simple accumulation de dispositifs administratifs ; il relève d’un écosystème inclusif où la condition citoyenne constitue à la fois un point de départ, un levier d’action et un indicateur de durabilité. Ainsi, le concept d’éco-citoyen prend toute sa dimension lorsqu’il exprime la convergence entre la conscience collective et la responsabilité intégrative dans la co-construction du territoire.
L’expérience de la Vigilance Sociale constitue un terrain d’observation privilégié pour comprendre la dynamique de l’éco-citoyenneté en action. Elle permet d’analyser comment la participation, la solidarité, la coordination intergénérationnelle et la convergence institutionnelle se traduisent concrètement dans la gouvernance locale. Par le biais de l’implication conjointe des institutions et des citoyens, cette initiative révèle comment la co-construction du territoire peut devenir un processus d’apprentissage collectif et de responsabilisation partagée.
Les témoignages recueillis auprès des bénéficiaires et des équipes illustrent cette dynamique territoriale intégrée.
Abdo, 35 ans, raconte :
« Avant mon intégration à la Cellule de Vigilance Sociale, je vivais partagé, bouleversé entre le virtuel et le réel, critiquant ou partageant des histoires de cas sur les réseaux sociaux. Lorsque j’ai commencé à accompagner les malades mentaux, j’ai découvert la réalité du terrain, tout en participant à leur prise en charge sociale et en les accompagnant vers les hôpitaux grâce à l’ambulance mise à disposition par l’INDH. Cette expérience a profondément changé ma vision de la vie. Ma femme et moi sommes désormais engagés 24h/24, et nous éprouvons une réelle satisfaction lorsque nous accomplissons une mission socio‑humaine».
Cette expérience met en évidence la transformation du citoyen passif en acteur engagé par le biais de l’apprentissage par l’expérience où l’engagement concret redéfinit la responsabilité citoyenne.
Par ailleurs, Fati, 23 ans, témoigne :
« Le bénévolat a totalement transformé mon parcours, combinant études et art, et m’a permis de découvrir d’autres horizons, de créer des tableaux et de relier l’espace aux citoyens. Il m’a tracé un chemin multifonctionnel en participant à des compétitions artistiques internationales ; ceci m’a rappelé la valeur de mon pays, le Maroc, pays de paix, de tolérance et de solidarité »
Cet extrait de récit démontre que la création artistique peut devenir un levier d’épanouissement citoyen et d’inclusion.
De plus, Sakina, 30 ans, encadrante, souligne :
« Le suivi éducatif, sportif et psychosocial transforme le comportement et le langage des jeunes»
De son coté, Imane, 23 ans, assistante sociale, rapporte :
« Une jeune mère nous a dit : Vous m’avez redonné confiance en l’administration »
Ces témoignages illustrent l’impact concret de la proximité administrative sur la restauration de la confiance entre citoyens et institutions, conformément aux orientations royales en faveur de la transparence, de l’écoute et de la proximité dans les services publics.
En outre, Fatima, 60 ans, ajoute :
« Toutes les générations se retrouvent autour du bénévolat. Nos actions sont désormais structurées, encadrant les jeunes, les enfants et les femmes au sein du Croissant-Rouge. Au début, certains étaient spectateurs ou critiques ; progressivement, ils ont compris l’impact réel de notre engagement collectif ».
D’autre part, Rachid, 47 ans, membre du Croissant-Rouge, précise :
« Cette contribution intergénérationnelle met en relief la dynamique du bénévolat comme vecteur d’inclusion sociale et de transmission de valeurs solidaires, rejoignant pleinement les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Par la volonté de Dieu, le Maroc reste et restera une terre où prévalent la solidarité et la cohésion, au sein de chaque famille, à l’intérieur de chaque quartier et à l’échelle de l’ensemble de la société ».
Cette contribution intergénérationnelle met en relief la dynamique du bénévolat comme vecteur d’inclusion sociale et de transmission de valeurs solidaires.
onjointement, Wafaa, 25 ans, partage :
« Après une hospitalisation et la prise en charge par le programme de Vigilance Sociale, j’ai été formée dans un centre professionnel pour femmes et j’ai pu créer mon activité génératrice de revenus dans la couture, soutenue par l’INDH. Cela a ouvert un nouveau chapitre dans ma vie».
Ce cas met en lumière le lien fort entre inclusion sociale et autonomisation économique, confirmant la contribution de la Vigilance Sociale à la résilience et à l’insertion socio-économique, conformément aux orientations royales en faveur de l’autonomisation des femmes et des jeunes.
Parallèlement, Ahmed, médecin urgentiste, 55 ans, confie :
« Avec la Vigilance Sociale, l’urgence se concrétise sur le terrain tout en complétant notre travail hospitalier et en équilibrant les cas précaires. J’ai été entouré de différentes générations, formant une équipe prête à intervenir matin, soir ou nuit. Cette expérience transforme le désespoir des bénéficiaires en espoir et révèle la puissance de la solidarité intergénérationnelle».
Ce témoignage met en évidence comment la coordination entre institutions et société civile reflète la vision royale, fondée sur l’engagement citoyen, la réactivité et la dimension humaine dans la gestion des situations vulnérables.
En complément, Tayeb, 63 ans, retraité, rappelle :
« Le travail social et le bénévolat sont des valeurs vécues au quotidien, traduisant la solidarité marocaine même à travers de simples actions ».
Ce témoignage illustre également le rôle structurant du bénévolat dans la cohésion sociale et la résilience communautaire.
Enfin, Reda, 21 ans, étudiant, relate :
« J’ai assisté à une intervention de la cellule de vigilance. Une personne âgée désorientée se trouvait près de la gare routière. En trois minutes, l’ambulance de la protection civile et le représentant de l’autorité locale étaient sur place. La personne a été transférée à l’hôpital, soignée, identifiée et remise à sa famille le lendemain ».
Cette intervention illustre la réactivité, la coordination opérationnelle et l’efficacité du maillage territorial, traduisant la mise en œuvre concrète des principes royaux de proximité, de responsabilité et de gouvernance efficace.
Ces expériences mettent en évidence la boussole d’un écosystème social structuré, fondé sur la participation, la solidarité et la coresponsabilité. Le modèle repose sur quatre leviers interdépendants : responsabilisation intégrative, apprentissage par l’expérience, engagement concret et contribution au bien commun.
Ainsi, le citoyen producteur devient non seulement acteur de sa propre trajectoire, mais également catalyseur d’un changement collectif durable, participant ainsi à la construction d’un écosystème social résilient, inclusif et innovant.
A ce titre, la Vigilance Sociale s’affirme comme un modèle de gouvernance territoriale participative, en parfaite cohérence avec les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, qui souligne l’importance d’une mobilisation citoyenne consciente et d’une proximité administrative effective pour garantir un développement humain durable et une société unie autour des valeurs de cohésion, de dignité et de justice sociale.
Le fonctionnement concret de cet écosystème repose sur une interaction systémique entre dispositifs institutionnels et dynamiques sociales locales. Ainsi, il ne s’agit pas d’une simple juxtaposition d’initiatives, mais d’un processus de co-construction où institutions publiques, acteurs associatifs et citoyens s’inscrivent dans une logique de complémentarité fonctionnelle. En pratique, cet écosystème combine la décentralisation de l’action publique vers le terrain et le renforcement du rôle des citoyens, qui deviennent de véritables co‑acteurs du développement.
En conséquence, les programmes institutionnels s’appuient sur l’engagement citoyen comme socle fondamental, garantissant légitimité, structuration et pérennité de leurs actions tout en élargissant leur impact. Dans cette perspective, la Vigilance Sociale démontre que la gouvernance participative ne se décrète pas : elle se construit au quotidien à travers l’écoute, la coordination et la mutualisation des ressources. Cette dynamique dépasse ainsi la simple responsabilité individuelle ; elle s’épanouit dans une approche collective qui relie quartiers, écoles, structures de santé et espaces culturels et artistiques. Concrètement, elle se traduit par des initiatives de propreté, des jardins partagés et des activités culturelles, sportives ou solidaires, tissant des liens de confiance et consolidant la cohésion sociale, tout en contribuant au renforcement du capital social et du tissu communautaire.
Au regard de cette dynamique, l’éco-citoyenneté se concrétise dans différents domaines, et le football national en constitue un exemple significatif. Structuré autour du joueur citoyen, de la Fédération Royale Marocaine de Football et de l’Académie Mohammed VI de Football, il incarne comment la confiance, la rigueur, la solidarité et la volonté d’excellence peuvent organiser et fédérer un collectif performant. A l’image de la niya, foi sincère et énergie morale qui anime les équipes nationales, cette dimension éthique constitue un pilier essentiel pour l’engagement collectif et la responsabilité partagée. De la même manière, l’éco-citoyenneté s’appuie sur cette foi sincère et cette énergie morale pour inspirer la mobilisation sociale, renforcer les liens communautaires et orienter les actions citoyennes vers le bien commun.
Dès lors, le sport devient un facteur puissant de formation citoyenne et de cohésion sociale, apportant une valeur ajoutée tangible en cultivant l’esprit collectif et l’engagement responsable.
Dans la continuité de cette dynamique, un autre modèle d’innovation citoyenne est porté par l’Université Mohammed VI Polytechnique, qui agit comme un Living Lab stratégique, stimulant l’innovation et la capacité d’action des citoyens. En promouvant l’apprentissage par l’expérience et en développant des compétences adaptées aux besoins territoriaux et sociétaux, elle transforme l’éducation en un outil concret de participation citoyenne et de co-construction territoriale. A travers ses programmes (Social Innovation Lab, Entrepreneur Academy) l’université produit des solutions locales durables et inclusives, générant une valeur ajoutée directe pour les communautés et les institutions.
Par ailleurs, le modèle socio-communautaire du Groupe OCP consolide et amplifie cette dynamique écosystémique à travers sa stratégie territoriale et ses initiatives innovantes dans les domaines social, sportif, éducatif, environnemental, industriel, culturel et citoyen. En mobilisant les institutions, les collectivités territoriales, la société civile, les citoyens et les acteurs économiques dans une logique de co-construction durable, l’entreprise accroît l’impact des actions collectives et favorise un développement territorial intégré. De ce fait, l’engagement coordonné du secteur privé illustre sa capacité à convertir les initiatives individuelles et collectives en projets concrets et durables, générant un impact bénéfique pour l’ensemble de la société.
En synthèse, la transformation du citoyen bénéficiaire en citoyen producteur démontre l’importance de l’engagement collectif partagé dans la co-construction du territoire. Les expériences issues du sport, de l’éducation, de l’innovation sociale et des actions communautaires révèlent que l’articulation harmonieuse entre citoyens, institutions et acteurs économiques favorise un écosystème citoyen intégré, capable de renforcer la cohésion sociale, de stimuler la responsabilité partagée et de soutenir un développement durable et inclusif. Le citoyen producteur devient ainsi un véritable facteur de changement collectif, contribuant à l’émergence d’un territoire solidaire, innovant et résilient.
Conclusion :
L’expérience de Vigilance Sociale initiée dans la province de Khouribga constitue une référence pionnière, démontrant la mise en œuvre d’un développement territorial intégré, articulé autour de la participation citoyenne, de la coordination institutionnelle et de la gouvernance de proximité. Dans cette perspective, elle se conçoit comme un laboratoire vivant, transformant la relation entre citoyens et institutions en un écosystème d’action et de confiance mutuelle, où la gouvernance locale devient à la fois concrète et partagée.
Concrètement, lancée le 28 septembre 2021, cette initiative est issue d’une rencontre structurante avec le responsable territorial, posant les fondations d’une dynamique d’innovation sociale et de co-construction citoyenne. De surcroît, le 5 octobre 2021, le premier cas de terrain identifié grâce aux signalements citoyens sur les réseaux sociaux a marqué le démarrage opérationnel du programme.
Au fil du temps, cinq années d’expérimentation ont consolidé la Vigilance Sociale comme un maillon stratégique de la chaîne allant de l’accueil à l’inclusion, révélant le territoire comme un écosystème vivant et interactif. Plus précisément, le territoire se définit désormais comme un système articulant trois dimensions complémentaires :
• Les vies, à travers l’amélioration du bien-être, de la santé et de la dignité humaine ;
• Les liens, par la restauration de la confiance envers les institutions, la solidarité et la cohésion sociale ;
• Les lieux, via l’ancrage territorial, la valorisation du patrimoine, de la mémoire locale et la réappropriation des espaces collectifs.
Ainsi, cette triade ( vies, liens, lieux ) constitue la pierre angulaire d’une architecture intégrée du développement, dans laquelle citoyens et institutions deviennent co-acteurs de la transformation territoriale.
Sur le plan opérationnel, la Vigilance Sociale s’appuie sur des mécanismes complémentaires et interconnectés. D’abord, le ciblage temporel organise les cycles d’action autour de la planification, de l’expérimentation, de l’évaluation et de la généralisation. Ensuite, le ciblage spatial concentre l’action sur les zones vulnérables et à fort potentiel humain, tandis que le ciblage comportemental mobilise citoyens et fonctionnaires dans une culture d’engagement civique et participatif. Par ailleurs, l’ingénierie sociale territoriale favorise la coordination intersectorielle, l’innovation sociale et la gouvernance numérique. Enfin, la cartographie dynamique permet d’identifier et de mutualiser les ressources, compétences et initiatives locales. Collectivement, ces mécanismes traduisent une gouvernance adaptative, alignée sur la vision royale, centrée sur la proximité, la justice sociale et l’intelligence collective.
De manière stratégique, la Vigilance Sociale renforce la culture civique et la responsabilité partagée, transformant les citoyens en acteurs capables de co-construire des solutions avec les institutions. La capitalisation des pratiques réussies permet non seulement de reproduire l’expérience à l’échelle nationale, mais aussi de créer un modèle d’apprentissage institutionnel et citoyen durable. En conséquence, elle constitue un vecteur de résilience et de durabilité territoriale, reliant cohésion sociale, innovation et compétitivité économique.
En effet, l’investissement dans le social renforce la compétitivité territoriale et consolide une culture de l’intelligence collective, faisant du territoire un espace vivant et capable de générer des solutions adaptatives face aux défis futurs. Ainsi, la combinaison de pratiques concrètes, de capitalisation des acquis et de partage d’expérience crée un modèle exportable, transformant le développement territorial en une architecture systémique et intégrée. Il apparaît donc essentiel que cette expérience soit généralisée dans d’autres provinces et régions, afin de renforcer l’impact national et de consolider une gouvernance locale participative et résiliente.
En synthèse, la Vigilance Sociale de Khouribga illustre un modèle stratégique de développement intégré. Son sens profond est d’humaniser la gouvernance et de transformer le territoire en écosystème vivant.
Pour y parvenir, elle repose sur l’expérimentation, permettant de tester, ajuster et adapter les solutions grâce à l’engagement citoyen et aux mécanismes institutionnels, tout en capitalisant les bonnes pratiques pour créer un référentiel réplicable et structurant. Ainsi, cette expérience démontre que la synergie entre citoyens, institutions et territoires peut générer une transformation durable, faisant de la Vigilance Sociale un levier de développement résilient, inclusif et porteur de sens pour la société
Références bibliographies :
Ouvrages
Friedmann, J. (1966). Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. Cambridge, MA : MIT Press.
Raffestin, C. (1980). Pour une géographie du pouvoir. Paris : Librairies Techniques.
Di Méo, G. (1998). Géographie sociale et territoires. Paris : Nathan.
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge : Cambridge University Press.
Morin, E. (1990). Introduction à la pensée complexe. Paris : Seuil.
Morin, E., & Le Moigne, J.-L. (1999). L’intelligence de la complexité. Paris : L’Harmattan.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York : Simon & Schuster.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). Marketing Management (16ᵉ éd.). Paris : Pearson.
Adam Smith. (1776). La richesse des nations.
G. S. Becker. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, New York.
Leif Edvinson & Michael Malone. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower. Collins.
Sen, A. (2003). Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté (2ᵉ éd.). Odile Jacob.
Articles
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.
Beyer, C., & Royoux, D. (2015). L’aménagement temporel territorial : repenser les territoires en conjuguant espace et rythmes. Métropoles, (17). https://journals.openedition.org/metropoles/5193
Santamaria, F. (1999). Le Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC). Cybergeo. https://journals.openedition.org/cybergeo/22354
Ouakrat, A. (2012). Le ciblage comportemental, une perte de contrôle des éditeurs sur les données de l’audience. Tic & Société, 6(1). https://journals.openedition.org/ticetsociete/1251
Ferey, G., Rousseau, S., & Giuliano, S. (2019). Laboratoire vivant (Living Lab). Dictionnaire d’agroécologie, ENSAV.
Daanoune, R., & El Arfaoui, M. (2018). Le concept du capital immatériel : l’ambiguïté d’une terminologie. Journal of Academic Finance, 9(1).
Stéphanie Fraisse-D’olimpio. (2009). Les fondements de la théorie du capital humain. SES-ENS.
Stiglitz, J. (2000). Vers un nouveau paradigme de développement, L’économie politique, 5, 5–3.
Michel Vernières. (2004). La notion de développement humain. Séminaire Institutions et Développement, p.2.
Rapports :
Usabilis. (2020). Le Design Thinking : méthode centrée sur l’humain et tournée vers l’innovation. https://usabilis.com/quest-ce-que-le-design-thinking/
Cairn Info. (2020). Le prototypage comme outil collaboratif d’aide à la décision. https://shs.cairn.info/pro-en-marketing--9782311622317-page-190
Le Matin. (2023). Le civisme en crise : une urgence nationale à l’approche du Mondial 2030.https://lematin.ma/nation/le-civisme-en-crise-une-urgence-nationale-a-lapproche-du-mondial-2030/282259



 الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 














 Architecture du développement territorial intégré
Architecture du développement territorial intégré